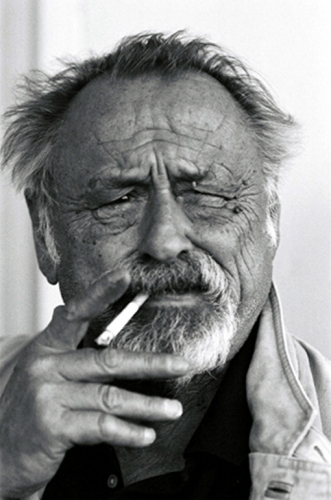DR
« Il vit des traces d’oiseau sous le niveau de la marée haute, là où la ligne de gravillon noir et rouge cédait la place à une boue sablonneuse. Ces traces de pattes semblaient tomber du ciel, comme si Dieu venait de donner forme à l’une de ses créatures et de la déposer là. Trois ergots s’enfonçaient dans la boue, reliés par de larges palmes. L’oiseau avait marché, tel un homme, sur la grève, d’un pas ferme et décidé. Le cou penché en avant, Clare suivit ces empreintes de pattes.
Elles semblaient pourtant absurdes, ces traces, comme si l’oiseau avait perdu la tête. Abruptement, elles s’arrêtèrent, les deux pattes profondément enfoncées dans la boue au niveau des ergots. Ces traces s’interrompaient sans raison : la boue redevenait lisse, l’oiseau s’était envolé. Clare se retourna et constata que son propre passage avait lui aussi laissé des empreintes bien nettes sur le gravillon ; il laissait ses propres traces, qui aboutissaient sous ses chaussures.
Il était, depuis le début, une bobine d’empreintes de pas qui commençaient un peu plus au nord, dans la cabane du campement dressée sur la plage où il avait appris à se tenir debout en s’accrochant à la jupe noire de sa mère. Ses traces disparaissaient, puis redevenaient visibles à mesure qu’il égrenait ses jours et ses ans ; il passa douze années à Goshen avant de revenir à Whatcom et il effectua d’innombrables allées et venues entre son domicile et le lycée, puis le bureau. Maintenant, sur cette plage, ses traces se dévidaient derrière lui telles une épluchure : le temps était un couteau qui l’épluchait comme une pomme et il allait continuer de l’entailler jusqu’à la fin. Ses traces, les traces de sa vie se termineraient abruptement, elles aussi – mais à ce moment là il ne s’envoleraient pas, comme un oiseau dans le ciel ; il descendrait sous terre.
“Je rejoindrai les portes de la tombe”, pensa Clare. C’était un passage d’Isaïe, dans lequel le roi mourant Ezéchias se tourne vers le mur. “Je rejoindrai les portes de la tombe : je suis privé du reste de mes ans. J’ai dit : je ne verrai pas le Seigneur, même le Seigneur, au pays des vivants : je ne contemplerai plus l’homme parmi les habitants du monde.”
Personne ne savait quel pas serait le dernier, à quel pas prendre garde. Où sur la face de la Terre, ses traces de pas seraient encore fraîches quand le trappeur le traquera ? Les garçons de la ville porteraient ensuite son corps en suivant ses derniers itinéraires.
Il avait besoin d’apprendre à mourir. Il avait appris tout le reste au fil du temps : à lire, à mener un équipage de bœufs, à faucher un champ et à vanner le grain, à abattre un arbre, à assembler deux pièces de bois à onglet, à utiliser et à réparer un tour ou une scie à vapeur, à expliquer l’électromagnétisme, à installer des pannes de toit, à couper des tuyaux de plomb pour un évier, à fabriquer un palier d’essieu, estimer une section de terrain, vendre une parcelle. Il excellait dans tout ce qu’il avait appris, mais il lui fallait maintenant apprendre cette chose nouvelle qui revenait à abandonner tout le reste. N’était-ce pas essentiel ? Mais comment apprend-on à mourir quand les experts en la matière restent muets ?
Le vieux Conrad Grogan, le géomètre, avait bien failli mourir ; il avait bel et bien trépassé, mais il était revenu à la vie pour se lever, maigre et très droit – sa moustache noire peignée au-dessus de ses lèvres, son chapeau jaune tout déchiqueté, la bedaine en avant et l’air sagace – et il avait vécu six autres années. Clare eut alors le sentiment que Conrad Grogan se jetait à corps perdu dans le temps qui lui restait à vivre : il fonda la société des débats, épousa une veuve défavorisée par le sort sur l’île de Whitbey, la ramena sur le continent, bâtit une maison dans un arbre pour les petits-enfants de sa femme, se construisit pour lui-même un modeste doris à voiles peint en rouge, et il arpentait les rues de la ville avec entrain, le visage ridé et rayonnant. Puis il s’alita, se mit à hurler pendant quelques jours, ahana durant autant de jours, devint tout violacé et mourut. Clare ignorait si Conrad Grogan était mort dignement, la première ou la dernière fois, ou comment cela se passait quand on avait seulement quelques vagues notions sur la mort, ou s’il pourrait s’arranger pour qu’on exige de lui une qualité qu’il fournirait alors aussitôt, par exemple du courage, une qualité qui n’aurait pas pour but de faire tomber la tension, mais qui au contraire lui plairait et dépasserait tout ce qu’il avait appris. »
Annie Dillard
Les vivants
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Brice Matthieussent
Christian Bourgois, 1994, coll. Titres n° 111, 2011