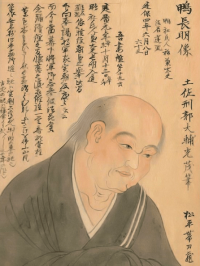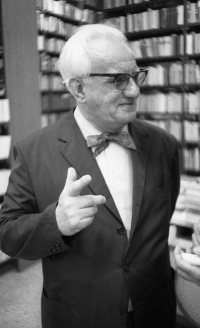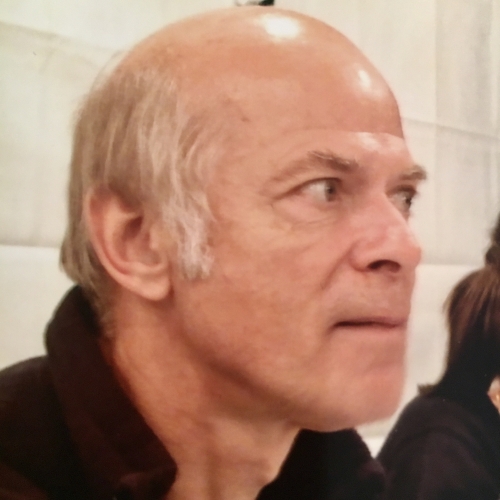Florence Delay, « La séduction brève »

« Le baiser court est infiniment plus vif et troublant que le baiser long qui est une fin en soi et c’est pourquoi la nouvelle, forme brève, séduit, à l’opposé du roman si long qu’il faut y revenir, y demeurer, et qui parle d’amour. La séduction est liée à des moments brefs, détachables et détachés du cours de l’existence, sorte de création artificielle, électrique, proche de la ré-création. Je n’en ai pas le sentiment tragique. Il est hélas de plus en plus rare d’être troublé puisqu’à l’imitation des écrits qui parlent d’écriture, les femmes, les hommes, parlent de plus en plus volontiers librement d’eux-mêmes à des fins confessionnelles. Se raconter dans l’espoir d’être guéri au lieu d’attendre d’être blessé, d’être compris au lieu d’être rapté, ne plus considérer l’autre comme un miroir, une fontaine, mais comme un analyste, aplanit terriblement le monde.
Dans ces circonstances il ne reste plus qu’à essayer de troubler et passer de l’état d’être séduit à celui de séducteur, activité joyeuse, non convenue, légère au sens de non pesante, qui met la durée en péril. »
Florence Delay
La séduction brève
Collection « Comme », dirigée par Bernard Noël
Les Cahiers des Brisants, 1987 – repris en 1997 aux éditions Gallimard
Chère Florence, je garde les beaux souvenirs, chez vous à Paris, à Bordeaux, Biarritz, Saint-Étienne-de Baïgorry, à Dax, à Madrid, autour des si doux Seins de Ramón Gómez de la Serna (le dessin que vous m‘avez donné est là, tout près), aux arènes…, nos longues conversations, votre si beau sourire, nos amis merveilleux : Michel Chaillou, Jacques Roubaud, Francis Marmande…, et tous vos livres épatants.
Si chère Florence, vous nous manquez déjà.