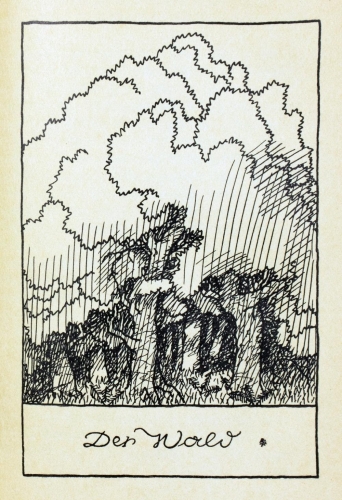Zhang Lei, « Colophon à une peinture de cheval de Han Gan »

Han Gan, vers 750
Tête comme phénix qui prend son envol, joues sous la lune lumineuses,
Dos stable comme un char, poitrail carré comme d’une sarcelle.
Intimement conscient de n’être fait pour conduire les paysans des champs,
Toujours du fils du Ciel de l’Ère inaugurale, il porte les parfums de la robe carmin.
Lorsque Han Gan l’écrivit et le traça, dans un pays sans trouble,
Sous l’ombre basse des arbres verts le printemps grandissait dans le jour.
Ses favoris tenus par les rênes, majestueux, sur le côté,
Comme s’il voyait au loin sur la route impériale s’étendre les palais.
Mais dans le vent du nord soulevant les poussières, le brigand de Yan devint fol,
Et les mille étalons de toutes les écuries lui revinrent à Fanyang*.
L'empereur à mulet prit la route de Shu,
Les luzernes qui bordent les rivières en vain diffusent leurs senteurs. »
* Fanyang, dans la région de Pékin, est le lieu où An Lushan (703-757), le brigand de Yan, entré en conflit avec le clan de Yang Guifei, lança son expédition contre les Tang et mit à sac la capitale Chang’an en 715.
« La dynastie des Song du Nord »
Traduit, présenté et annoté par Stéphane Feuillas
in Anthologie de la poésie chinoise
La Pléiade, Gallimard, 2015
Bonne année du Cheval de Feu