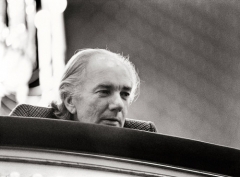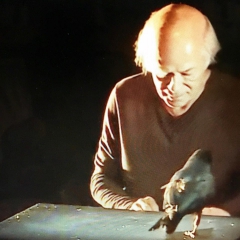Pier Paolo Pasolini, « La religion de notre temps »
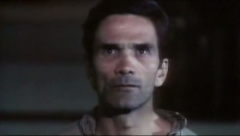
PPP en Giotto dans Le Décaméron, 1971
« Si – ne les voyant plus depuis deux jours seulement,
maintenant, en les revoyant, à ma fenêtre, un court
instant, là-bas, ignorés, disgracieux,
tandis qu’ils grimpent sous un soleil blanc comme neige,
je retiens à grand-peine un enfantin sanglot –
que ferais-je, quand, ayant acquitté toute dette
ici-bas, se sera perdu mon dernier râle
depuis mille ans déjà, depuis l’éternité ?
Deux jours de fièvre ! Au point
de ne plus pouvoir supporter le décor,
si insensiblement changé soit-il par les chaudes
nuées d’octobre, et si moderne
désormais – qu’il me semble ne pouvoir plus
le comprendre – en ces deux gosses qui remontent la rue,
là-bas, au fond, à l’aube de la jeunesse…
Disgracieux, ignorés : et pourtant leurs cheveux
reluisent d’une joyeuse couche
de brillantine – volée dans l’armoire
d’un frère aîné ; tandis que sont fanés
par de millénaires soleils citadins
leurs pantalons de toile, que le soleil d’Ostie
et le vent ont décolorés ; et pourtant c’est un fin
travail que le peigne a consolidé
sur les chevelures aux mèches blondes bien démêlées.
À l’angle d’un immeuble, ils apparaissent,
debout, mais fatigués par la montée,
et je vois disparaître, en dernier, leurs jarrets,
à l’angle d’un second immeuble. Il semble
que la vie, depuis toujours, se soit arrêtée.
Le soleil, la couleur du ciel, cette hostile
douceur, que l’air assombri
de spectres de nuées, redonne aux choses,
tout se passe comme en une heure
révolue de ma vie : de mystérieux
matins de Bologne ou de Casarsa,
douloureux et parfaits comme des roses,
renaissent de nouveau, ici, dans la lumière
que contemplent les yeux abattus d’un enfant
qui ne connaît en tout et pour tout que l’art
de se perdre, motif lumineux sur fond sombre.
Alors que je n’ai jamais péché : je suis
aussi pur qu’un vieux saint, aussi
n’ai-je rien eu ; le don
désespéré du sexe, tout entier,
s’est enfui en fumée : je suis bon
comme un fou. Mon passé
tel que me l’a assigné le destin
n’est rien d’autre qu’un vide inconsolé…
et consolant. J’observe, en me penchant
à ma fenêtre, ces deux gamins qui vont, légers,
sous le soleil ; et je suis là, comme un enfant
que tourmente, bien sûr, ce qu’il n’a pas connu,
mais aussi tout ce qu’il ne connaîtra point…
Et en ces pleurs, le monde est une odeur,
rien d’autre : des violettes, des près, que connaît bien
ma mère, et en quels printemps…
Une odeur qui ondoie pour devenir, là
où les pleurs sont doux, matière
à expression, nuance… la voix
familière de cette langue folle et vraie
que j’eus à ma naissance et que suspend la vie. »
Pier Paolo Pasolini
Poésies 1953-1964
Bilingue
Traduit de l’italien par José Guidi
Gallimard, 1973, rééd. Poésir Gallimard n° 140, 2017