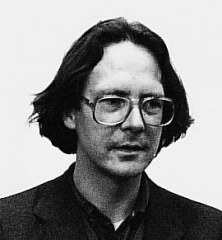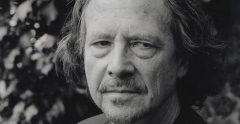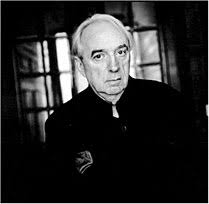Sima Guang, « Sur les rimes du poème de Shao Yaofu, “Chant des activités dans le nid de la joie paisible” »

« Dans la terrasse magique, libre de toute affaire, chaque jour ouvert et gai,
Paisible et joyeux, revenu à la source, il ne cherche rien au-dehors.
Lorsqu’il bruine et que souffle le vent froid, il reste seul assis,
Et quand le ciel est clair et les scènes sont belles, il randonne à son aise.
Les pins et les bambous ouvrent à suffisance ses yeux noirs,
Et qui l’empêche d’épingler sur sa tête blanchie des fleurs de pêchers ?
Moi qui ai pour mission de rédiger des livres,
Pour vous je volerai un instant et monterai sur le haut pavillon… »
Sima Guang – 1019-1086
« La dynastie des Song du Nord — 960-1127 »
Textes traduits, présentés et annotés par Stéphane Feuillas
Anthologie de la poésie chinoise
La Pléiade, Gallimard, 2015