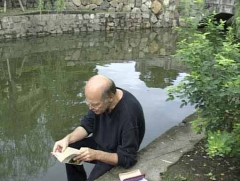Li Bai, « J’interroge la lune, une coupe de vin à la main »

Li Bai, DR
« Lune dans le ciel bleu, depuis quand es-tu là ?
Je te pose la question, une coupe à la main.
L’homme ne peut pas monter sur la lune claire ;
Mais la lune se promène toujours avec l’homme.
Miroir aérien brillant sur la porte rouge du palais ;
Elle répand un éclat pur quand la brume se dissipe.
On la voit se lever dans la nuit au-dessus de la mer ;
On oublie qu’elle se noyait dans les nuages du matin.
Le lièvre blanc y pile la drogue magique jour et nuit ;
Chang’e y habite seule, sans connaître de voisins*.
Les gens d’aujourd’hui, n’ont pas vu la lune d’antan ;
La lune d’aujourd’hui, elle, a éclairé les gens de jadis.
Gens d’aujourd’hui et de jadis : de l’eau qui coule ;
Mais c’est toujours la même lune qu’on contemple.
Puisse au moment où nous chantons face au vin
L’éclat du clair de lune illuminer nos coupes dorées. »
* Chang’e (ou Heng’e), enfuie dans la lune, en devint la déesse.
Li Bai – 701-762
« La dynastie des Song du Nord »
Traduit, présenté et annoté par Florence Hu-Sterk
In Anthologie de la poésie chinoise
La Pléiade, Gallimard, 2015