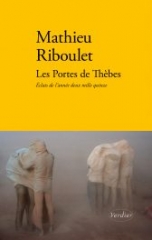Vélimir Khlebnikov, « La famine »

Vélimir Khlebnikov par Vladimir Maïakovski, 1913
« Pourquoi cerfs et lièvres galopent dans les bois d’automne
s’éloignant au loin ?
Les hommes ont mangé l’écorce du tremble
les pousses vertes des sapins
Femmes et enfants errent dans les bois
ils cueillent des feuilles de bouleau
pour faire de la soupe aux choux de la soupe froide du borchtch
Sommités des sapins et mousse tendrement argentée –
nourriture des bois
Les sapins rendront les dents semblables à celles du cerf
“Plus de glands ! Les hommes ont mangé tous les glands” –
sautillait se plaignait l’écureuil
Dans les bois taupes et souris ont disparu
nulle part le renard ne peut attraper la volaille
La femelle du lièvre fuit mécontente –
le chou a disparu des potagers
Les enfants éclaireurs de nourriture
errent dans les bosquets
grillent sur des feux les vers blancs
les grandes mauves des bois et les chenilles grasses
les vers gras des lucanes
ils les déterrent et se les mettent sous la dent
cuisent de petits pains d’arroche
la faim les fait courir après les papillons
Et les petits enfants gazouillent doucement comme font les enfants
ils parlent d’autres temps
leurs yeux en énorme tache sombre
Pour que la famine regarde à travers les visages d’enfant
comme un maître barbu
Les petits enfants fondent
Leurs bouches sont devenues énormes se sont étirées jusqu’aux oreilles
leurs yeux comme des cernes bleus ou noirs
brillent en cercle sur les visages comme un miroir lisse
l’arête du nez s’est affinée
pointue comme un canif avec son extrémité blême d’oiseau
Les enfants dans la forêt
brillent face au monde comme un cierge blanc près du cercueil
Tous se sont perdus dans la contemplation ravie
d’un lièvre qui tendrement bondissant
galope dans les bois
comme à l’apparition d’un esprit lumineux
Mais il s’enfuit vision légère
le bout de son oreille faisant une tache noire
Et les enfants longtemps sont restés par lui fascinés
C’est un repas copieux qui s’est envolé
Si on avait pu le rôtir et le manger !
Feuille douce savoureuse d’entre les savoureuses
petite herbe douce plus douce que craquelin
“Regarde un peu un papillon là-bas est passé” –
“Attrape-le course-le et ici un bleu” –
Un garçon dans la rivière a attrapé
trois grenouilles
grasses grosses et vertes
“Mieux que le poulet ” –
disait-il à ses sœurs réjouies
Le soir les enfants se réuniront près du feu
et mangeront ensemble les grenouilles
en babillant doucement
Et peut-être aujourd’hui il y aura une soupe de papillons »
1921
Vélimir Khlebnikov
Œuvres — 1919 – 1922
Traduit du russe préfacé et annoté par Yvan Mignot
coll. « Slovo », Verdier, 2017
https://editions-verdier.fr/auteur/velimir-khlebnikov/
Depuis sa parution, en 2017, ce livre ne quitte pas mon établi. La puissance de l'écriture de Khlebnikov me sidère — et donc la traduction d'Yvan Mignot — et je ne suis pas loin de penser comme Jakobson qu'« il était, pour le dire en un mot, le plus grand poète du monde en notre siècle ». Du moins un des plus importants, un des plus inattendus, un des plus neufs qui soient encore aujourd'hui.