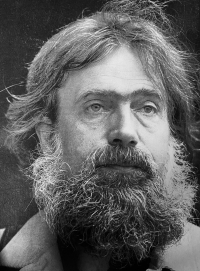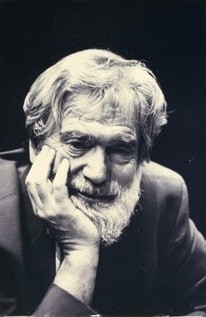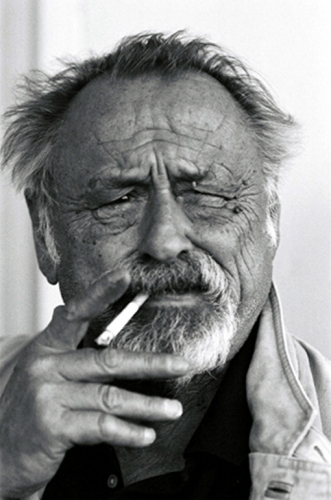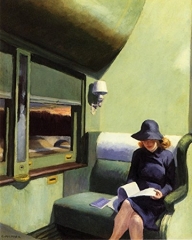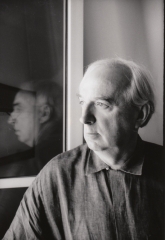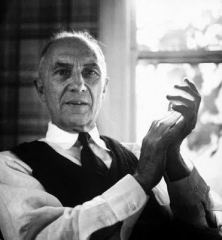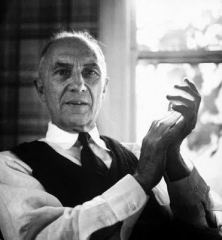
DR
« Le manque de livres
nous conduira parfois en esprit jusqu’aux bibliothèques par un chaud après-midi, si toutefois les livres peuvent nous faire défaut au point d’entraîner notre esprit.
Car il existe un vent ou l’esprit d’un vent
dans chaque livre qui renvoie la vie
jusqu’ici, un grand vent qui emplit les conduits
auriculaires jusqu’à ce que nous croyons entendre le vent
réel
entraîner notre esprit.
En émergeant des rues, nous brisons
l’isolement de notre esprit, et nous sommes emportés
dans le vent des livres, nous cherchons, cherchons
au gré du vent
jusqu’à ne plus distinguer le vent du
pouvoir qu’il a, sur nous,
d’entraîner notre esprit
et dans notre esprit monte
la senteur, peut-être, des fleurs de caroubier
dont le parfum est lui-même une vent qui souffle
en entraînant notre esprit
au travers duquel, sous la cataracte
bientôt à sec
la rivière roule, tourbillonne
calme jadis.
Épuisé d’avoir, ces derniers mois, cherché
des rues inutiles, des visages repliés contre
lui comme le trèfle au crépuscule, quelque chose
l’a réconcilié avec son
esprit .
dans lequel les chutes invisibles
tombent et s’élèvent
et croulent encore — sans fin, croulent
et recroulent en grondant, reflet
non point des chutes mais de leur incessant
tumulte
Quelle merveille,
ma belle que ceux, impuissants, qu’entraîne le vent,
qu’atteint le feu
impuissants,
un grondement qui (silencieux) submerge les sens
de sa répétition
qui refuse de s’étendre
pour dormir, dormir, dormir
sur son lit sombre.
L’été ! c’est l’été
-- Le grondement dans l’esprit est
incessant
Le dernier loup fut tué près de Weisse Huis en l’an 1723
Les livres nous reposeront parfois du
grondement de l’eau, qui croule
et s’élève pour crouler encore, emplissant
l’esprit de son reflet
pierre branlante. »
William Carlos Williams
Paterson (publié entre 1946 et 1958)
Traduit de l’américain par Yves di Manno
Préface de Serge Fauchereau
Coll. « Textes », Flammarion, 1981, 2e édition, revue et corrigée : Corti, 2005
http://www.jose-corti.fr/titres/paterson.html
La version ici recopiée d’un extrait du chapitre III La Bibliothèque est celle de la première édition.
Nous ne pouvons que conseiller au lecteur de voir l'épatant — culte déjà — film de Jim Jarmusch, Paterson, qui fait très précisément référence au livre de William Carlos Williams & au poète Ron Padgett. Vous trouvezrez, ci-dessous, un lien vers la BA :
https://www.youtube.com/watch?v=tF19bxM6qh0