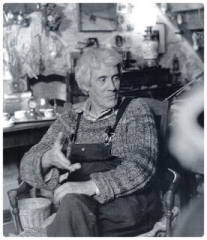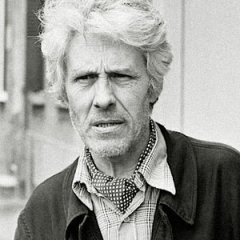Louis Calaferte, « Portrait de l’enfant »
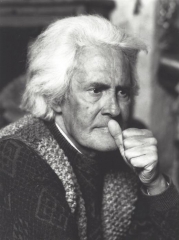
DR
« Seul dans la cuisine, par les chauds après-midi d’été, il découvrait ou inventait des visages de jeunes filles dans les bariolages de la toile cirée qui recouvrait la grande table poussée contre le mur.
Lorsqu’il avait situé leurs bouches, il y appliquait la sienne, longuement, amoureusement.
Il était malheureux de cette parodie de tendresse sans prolongement, sans échange.
[…]
Elle venait dans le noir jusqu’à son lit. Il entendait le bruissement de sa chemise de nuit. Elle s’asseyait à côté de lui, cherchait sa main, la retenait dans la sienne.
— Tu as peur ?
— Oui.
— Moi aussi, j’ai peur.
Sa voix était comme soufflée, lointaine, cotonneuse.
Elle rapprochait sa tête. Ses cheveux sentaient bon.
[…]
Sur le sentier au bord de la rivière, en un endroit où il savait que les promeneurs ne s’aventuraient guère, il édifiait autour de lui plusieurs petits puits de sable qu’il emplissait d’eau dans laquelle il précipitait les insectes de passage.
Assis au milieu de ses constructions, il lui suffisait de tourner la tête pour observer dans chaque cuvette, au cours de l’après-midi, les manifestations de ces lentes agonies.
Les insectes les plus gros se débattaient moins longtemps que les autres à la surface de l’eau. Après maintes vaines tentatives, ceux qui réussissaient à se hisser sur la paroi de sable avaient la vie sauve ; ils étaient peu nombreux. Certains, qu’il croyait morts, se ranimaient aussitôt qu’il les effleurait du doigt. Ce simulacre de leur part excitait contre eux sa colère, comme s’ils avaient eu la volonté consciente de le duper. Il leur accordait le temps de reprendre des forces en les retirant de l’eau où il les replongeait dès qu’ils paraissaient s’être rétablis. Parfois aussi, haineux, il les écrasait.
[…]
Plusieurs jours de suite il déroba le courrier dans la boîte aux lettres et alla le brûler dans l’ornière d’un champ, derrière un petit mur où il ne pouvait être vu.
En regardant les enveloppes se jaunir, se corner sous la chaleur de la flamme, il avait l’impression que beaucoup de choses malpropres, mauvaises, disparaissaient grâce à lui.
C’était inexplicable.
[…]
À l’église, certains dimanches, pendant la messe chantée, il voyait onduler la robe de la statue de la Vierge. Son visage mélancolique penché sur une épaule s’inclinait davantage. Elle lui adressait un sourire grave. Il avait la sensation qu’elle eût aimé lui parler.
Une joie douloureuse lui opprimait le cœur.
[…]
Il s’établissait sous la table de la cuisine, allongé à plat ventre sur un petit manteau de fourrure lui appartenant et s’y frottait jusqu’à la jouissance, si forte qu’elle lui fermait les yeux quelques secondes durant.
[…]
Insensiblement son lit d’enfant devient catafalque. Les draps se teintent, leur blancheur estompée, comme une clarté s’affaiblissant graduellement. Le sommier se surélève. Sous ses reins, il sent le matelas s’amincir, devinant peu à peu la dureté horizontale de la planche. Un homme entre dans la chambre, vient lui ôter son pyjama, qu’il remplace par son costume de velours. Ses mains sont croisées sur sa poitrine. Il a chaud. Il est bien. »
Louis Calaferte
Portrait de l’enfant
Denoël, 1969