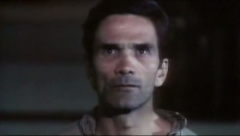Jacques Dupin, « Matière du souffle »

DR
« L’ambiguïté de l’empreinte : être le présent d’une image ou d’un signe, la marque brûlante, – et ensemble distance de l’une, absence de l’un, – une vieille histoire racontée marmonnée sans fin, et l’éclat de son futur imminent… Le battement de sa mort suspendue, sa dérogation d’être ici, son sursis, un élargissement de condamné, sa proximité, son éloignement, la barre, la ligne surchargée graffitée de son horizon…
Une image dont la violence (la témérité de la coupe) est comme inhibée, fortifiée, prolongée dans son éclat – par ce qui l’entame et l’incise, l’infléchit, l’enrobe et la brouille… Trop prompte, trop vite levée, pour être coupée de l’enclave nourricière, de la terre aveugle, et de la pensée du double…
——————————————————————————————————
Il s’en faut d’une montagne ouverte, et d’un corps de bête frôlée, de femme désirée – entre blessure, tatouage, rituel et sauvagerie… le même lancinant étirement d’un songe, et la trace accolée du double et de la proie, devant la béance de la montagne et la nuit des yeux de l’aimée…
…la nuit dont la grâce réfractaire affleure par le fendillement de l’étendue et la scarification de ses plaies… comme à l’écart de ce massif, de cette chaîne de peintures dont les voix de ruissellement baignent les racines et la danse… Un orgasme de la substance, un solipsisme de l’air, une accentuation du pli et du trait qui transgresse la voix païenne, et le cérémonial de la mise à nu – et la brûlerie d’aromates… »
Jacques Dupin
Matière du souffle (Antoni Tàpies)
Frontispice de Antoni Tàpies
Fourbis, 1994