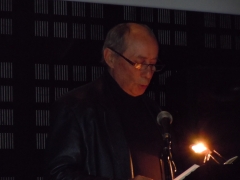Marc Mauguin, « Ponts coupés »

Gérard
(extrait)
« Alors pour rien de ce qui m’entoure venant de si loin jusqu’à aujourd’hui et peut-être demain, je ne trouverai plus de mot ? Ni mot ni voix désormais. Bien fini cette fois. Accepter. Cesser de m’asseoir à ma table tous les matins, après avoir pris mon café dans la cuisine pour ne pas l’éveiller, puisqu’il dort encore. Cesser de chercher, à tâtons dans la nuit, le stylo pour écrire sur le dos de ma main une phrase avortée des ténèbres. Trouver des occupations du matin jusqu’au soir, sans rien dire à personne. Le cinéma, la bibliothèque. Ou rien. Marcher dans les rues, passer le temps jusqu’à son retour. Rentrer un peu avant. Faire semblant. Tu as bien travaillé aujourd’hui ? C’est lui qui pose la question depuis quelques semaines, moi jamais, comme si ce que je faisais était le plus important alors que j’essaie de sourire. Quelques pages aujourd’hui. Des gribouillages. Il rit. Tu me feras lire ? Avant, il ne posait pas ces questions. Quand il rentrait j’écrivais encore, sans m’apercevoir que le jour était tombé. Dans le noir, de travers et à toute vitesse, guidé seulement par le contraste de l’encre foncée sur le papier blanc. Je m’arrêtais au milieu d’une phrase. Continue, je ne veux pas te déranger. Il parcourait, j’ignorais depuis combien de temps, les lignes par-dessus mon épaule. Puis s’éloignait sans rien dire, passait dans une autre pièce. Je n’entendais plus rien. Un moment après, je sentais sa main sur mon cou ; la nuit était tombée depuis longtemps. Il faut venir dîner. Les mêmes mots que ceux de maman. Il riait comme devant quelqu’un qu’on réveille, qui revient doucement à la vie avec l’empreinte du rêve dans les yeux. Tu es un insecte ! Mets tes lunettes. Riait encore. »
Marc Mauguin
Ponts coupés
L’Escampette, 2013
Trentième page pour fêter les vingt ans de L’Escampette