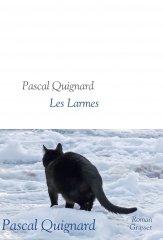Maurice Darmon, « La forêt des dames, le cinéma de Marguerite Duras 1964-1972 »

DR
« […] que cherche précisément Marguerite Duras du côté du cinéma ? Qu’en attend-elle en 1969 ? Que quitte-t-elle avec son dernier film, Les enfants, en 1985 ?
Déjà, ses premières clés :
J’avais fait un livre très rapidement ; c’est à dire qu’après avoir pensé à ce livre pendant un an, j’ai fait le livre en une semaine, dans des conditions mentales très difficiles, c’est-à-dire que c’est un livre qui m’a beaucoup angoissée et je ne le connaissais que très peu. J’ai eu envie de connaître mieux ce livre, donc de le voir et de l’entendre.*
Marguerite Duras n’est certainement pas la seule à mal connaître son propre roman. L’avalanche de dialogues et de tirets et sa petite musique emportent le lecteur dans une sorte d’indifférence à ce qui se passe et à qui parle pour se laisser faire par ce qui se dit. Mais comme son auteur, le lecteur éprouve bientôt la nécessité de “connaître” ce livre, qui, dès l’ouverture, livre ses marques originelles, celles d’un scénario :
Temps couvert.
Les baies sont fermées.
Du côté de la salle à manger où il se trouve, on ne peut pas voir le parc.**
L’auteur et son lecteur savent qu’en réalité un film impose là sa dictée. Elle ne connaissait pas son livre, elle naissait plutôt de lui, et la nécessité d’une figuration concrète, “de le voir et de l’entendre” s’imposait. Avec la force de ce qu’elle nomme “l’envie”. Tourner un film, c’est forcément livrer corps, voix et visages à chaque mot, à chaque réplique ; c’est abandonner toute leur place et leur durée aux espace et aux silences. Voir et entendre : qu’est-ce que le cinéma, sinon des images et des sons ? sinon reconnaître le geste documentaire comme un épicentre dans le tremblement des lumières et des bruits ? »
* Entretien à la télévision canadienne du 7 décembre 1969
** Détruire dit-elle, Minuit, 1969
 Maurice Darmon
Maurice Darmon
La Forêt des dames. Le cinéma de Marguerite Duras, 1964 – 1972
(Sans merveille, la Musica, Détruite dit-elle, Jaune le soleil, Nathalie Granger
202 éditions, 2015