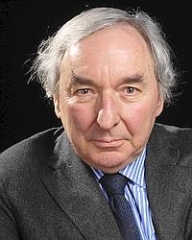Jean Clair, « Paranoïa »

Fresque de Gorgone dans la Casa dei Vettii, Pompéi
« […] Se retourner, réfléchir, relire, reprendre, c’est découvrir la face terrifiante de Méduse, subir son engourdissement qui mène à l’ankylose de la pierre. Rêver, c’est revenir, c’est devenir un revenant et commencer d’habiter chez les morts.
La mort n’est pas devant nous, comme on le croit communément, elle est derrière nous, dans notre dos. Se retourner, c’est découvrir sa face de nuit au cœur de la nuit même, et comme Orphée impatient, ne plus jamais, paralysé, revoir la lumière du petit jour. La mort n’est pas non plus un sac d’os, comme on la voit communément figurée dans les fresques du Campo Santo, une assemblée de squelettes qui s’agitent en une ronde de fête foraine. C’est un masque, immobile et seul.
On dit aussi que les souvenirs douloureux, insupportables, s’effacent avec le temps. La mémoire serait miséricordieuse. On oublierait qu’on a été malheureux. Mais non, il suffit de se retourner – et plus le temps s’avance, plus l’envie de se retourner grandit – pour voir qu’ils sont toujours là, et même on les redécouvre, immobiles, plus graves, plus lourds, plus pesants, avec leur rictus de pierre et leurs crocs prêts à déchirer, pour nous rappeler que cela a bien eu lieu, irrémédiablement, et qu’on ne pourra pas indéfiniment leur échapper.
Lorsqu’on relit un livre, qu’on réfléchit à ce qui a été, qu’on revoit un visage disparu, lorsqu’on s'arrête un instant, tout simplement, pour revenir sur un moment de son passé, de quelle mort est-on menacé dont l’élan du présent, si irréfléchi soit-il, nous protège ? Quel étrange équilibre doit-on conserver entre cette réflexion qui nous fait nous retourner sur soi au péril de la vie et de la démarche hésitante qui nous permet malgré tout de continuer d’avancer, d’écrire, d’aller droit son chemin en quête précisément de cette indicible vérité dont le pressentiment nous paralyse, et qui probablement nous tuerait s’il nous fallait l’affronter.
Croiser le regard de la Méduse, et aller jusqu’à oser lui trancher la tête, c’est alors se donner le pouvoir qu’elle ôte aux humains, celui de figurer, de représenter, d’imaginer ce qui a été et ce qui demeure. »
Jean Clair
Les derniers jours
Gallimard, 2013