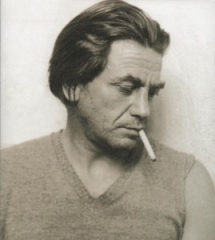Umberto Saba, « Deux poèmes »

DR
« Après la tristesse
Ce pain a goût de souvenir,
que j’ai mangé dans cette pauvre auberge,
au point le plus perdu, le plus encombré du port.
J’aime le goût amer de cette bière,
assis à mi-chemin du retour,
face aux montagnes ennuagées et au phare.
Mon âme venue à bout de l’une de ses peines
avec des yeux nouveaux dans le soir ancien
regarde un pilote avec sa femme enceinte ;
puis un bâtiment dont la vieille coque
lui au soleil, et dont la cheminée
longue comme ses deux mâts est un dessin
d’enfant que j’ai fait, il y a bien vingt ans.
Et qui m’aurait prédit ma vie
aussi belle, avec tant de doux tourments,
et tant de béatitude solitaire !
1910-1912
Pour une fable nouvelle
Tous les ans, un pas en avant et le monde dix
en arrière. À la fin, je suis resté seul.
Mais tu me rends ce que j’ai perdu, rossignol
qui te poses sur ma branche, et tu racontes
pour moi l’histoire de l’ange qui vit
deux jours et demi sur la terre. Ta main inexperte
écrit et fait en sorte qu’autour
de la fable nouvelle mes pensées
s’agglutinent avec ardeur comme des abeilles sur le miel.
Tu accuses la difficulté de l’art et les mots
d’être de glace pour l’image. Et moi, je pense
que tu es plus jeunot que ton âge ;
que celui qui mûrit vite (c’est un vieux dicton)
tombe en peu de temps de sa tige. »
1947-1948
Umberto Saba
Il Canzoniere
Traduit de l’italien par Odette Kaan, Nathalie Castagné, Laïla et Moënis Taha-Hussein et René de Ceccaty
L’Âge d’homme, 1988