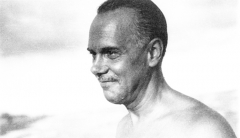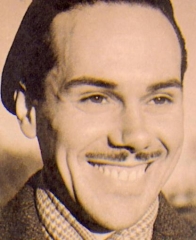Denise Levertov, « Septembre 1961 »

« C’est l’année où les anciens,
les grands anciens
nous ont laissés seuls sur la route.
La route mène à la mer.
Nous avons les mots dans nos poches,
d’obscures indications. Les anciens
nous ont ravi la lumière de leur présence,
nous la voyons s’éloigner sur la colline
et sur l’autre versant disparaître.
Ils ne sont pas mourants,
ils se sont retirés
dans une douloureuse solitude
apprenant à vivre sans les mots.
E.P. “Cela ressemble à la mort” — Williams : “Je ne peux
vous décrire
ce qui m’est arrivé” —
H.D. “incapable de parler.”
Les ténèbres
se tordent dans le vent, les étoiles
sont minuscules, l’horizon
est cerné par la lueur confuse de la ville.
Ils nous ont dit
que la route mène à la mer,
ils ont mis
le langage entre nos mains.
Nous entendons
le bruit de nos pas chaque fois qu’un camion
nous a croisés dans la lueur éblouissante des phares
nous laissant un nouveau silence.
On ne peut atteindre
la mer par cette interminable
route de la mer, à moins
de la quitter enfin, nous semble-t-il,
à moins de suivre
la chouette qui glisse là-haut, silencieuse
d’un vol oblique, passe et repasse,
se perd dans la forêt profonde.
Mais devant nous la route
se déploie, nous comptons les
mots dans nos poches, nous nous demandons
ce que sera la vie sans eux, nous ne
cessons de marcher, nous savons
que la quête sera longue, parfois
il nous semble que le vent de nuit
apporte l’odeur de la mer... »
Note : E.P., Ezra Pound. Williams, William Carlos Williams.
H.D., Hilda Doolittle.
Denise Levertov
Un jour commence
Traduit de l’anglais et préfacé par Jean Joubert
Les cahiers des brisants, 1988