Thomas Bernhard, « Un enfant »

« Les grands-pères sont les maîtres, les véritables philosophes de tout être humain, ils ouvrent toujours en grand le rideau que les autres ferment continuellement. Nous voyons, quand nous sommes en leur compagnie, ce qui est réellement, non seulement la salle, nous voyons la scène et nous voyons tout, derrière la scène. Depuis des millénaires les grands-pères créent le diable là où sans eux il n’y aurait que le Bon Dieu. Par eux nous avons l’expérience du spectacle entier dans son intégralité, non seulement du misérable reste, le reste mensonger, considéré comme une farce. Les grands-pères placent la tête de leur petit-fils là où il y a au moins quelque chose d’intéressant à voir, bien que ce ne soit pas toujours quelque chose d’élémentaire, et, par cette attention continuelle à l’essentiel qui leur est propre, ils nous affranchissent de la médiocrité désespérante dans laquelle, sans les grands-pères, indubitablement nous mourrions bientôt d’asphyxie. Mon grand-père me sauva du morne abrutissement et de la puanteur désolée de la tragédie de notre monde, dans laquelle des milliards et des milliards sont déjà morts d’asphyxie. Il me tira suffisamment tôt du bourbier universel non sans un processus douloureux de correction, heureusement la tête en premier, puis le reste du corps. Il dirigea mon attention suffisamment tôt mais effectivement il fut le seul à l’avoir dirigée, sur le fait que l’homme a une tête et sur ce que cela signifie. Sur le fait qu’en plus de sa capacité de marcher, la capacité de penser doit commencer aussitôt que possible. »
Thomas Bernhard
Un enfant
Traduit de l’allemand par Albert Kohn
Gallimard, 1984 (première édition allemande, 1982)
pour le 24 février 1890
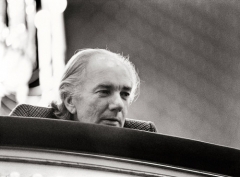
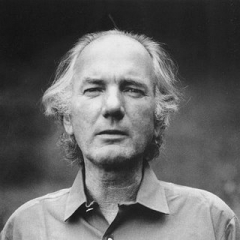
 Dans la très élégante collection à 6€10, Allia publie un premier livre, qui doit certes à Thomas Bernhard, mais surtout au fait même d’écrire, à l’angoisse, au découragement, à la folie… Tout de digressions souvent drôles, emmené par une pensée en effervescence, obsessionnelle et démentielle souvent, Le Découragement
Dans la très élégante collection à 6€10, Allia publie un premier livre, qui doit certes à Thomas Bernhard, mais surtout au fait même d’écrire, à l’angoisse, au découragement, à la folie… Tout de digressions souvent drôles, emmené par une pensée en effervescence, obsessionnelle et démentielle souvent, Le Découragement 