Jacques Réda, « Châteaux des courants d’air »

DR
« Mes fenêtres donnent à présent sur des jardins aux essences diverses – vernis du Japon, érables, marronniers, cytises, tilleuls, lilas, buddléias – échantillons bien spécifiques (il ne manque qu’un figuier) de ce que fournit spontanément la conjonction, sous cette latitude bénigne, d’une terre opiniâtre et du songe de jardin des Plantes qui hante ses occupants. Ainsi, très tôt le matin, quand le jour se diffuse comme du lait dans l’épaisse bouteille verte qui danse sous les ponts, d’un coup dix mille oiseaux actionnent les aiguilles et ciseaux d’un énorme atelier de couture, ou – par brouillard – se taisent pour exalter ce merle unique de l’enfance, appelant encore du cœur d’un monde plus pur que le cristal. Vers six heures, le soir, un soleil discret pénètre dans la cuisine, et s’y tient de profil comme une jeune femme qui repasse en souriant. Alors j’entends vibrer plus fort, symétrique de l’arc de la Seine, la corde qu’entre le pont Mirabeau et le pont de Tolbiac tend cette longue voie qui change quatre fois de nom, coupe trois arrondissements, y redistribue le trafic et la vadrouille vers les nefs vides de Citroën, les jardins cachés d’Alésia, les vallons de Montsouris et la farouche autonomie de la Butte-aux-Cailles. Unissant le clocher prétentieux d’Auteuil et la douce colonnade de la Nativité sous les rameaux païens de Bercy, elle s’insinue elle-même sous un fin poudroiement de feuillages. Acacias, gleditschias et autres espèces parentes ou ressemblantes (on s’y perd) s’y gravent en hiver sur des ciels tendrement lithographiques, et s’épanchent l’été dans les bleus par bouffées tropicales. Telles sont aussi la rue des Pyrénées ou la rue Caulaincourt, bien sûr indissociables des régions qu’elles desservent, délimitent, font communiquer, mais dont je sens mieux, la nuit, de mon nouveau point d’ancrage, quelle dimension mentale elles ajoutent au corps de la ville : rues en perpétuel mouvement comme dans les rêves, où c’est la ville qui se rêve et navigue en tout sens à travers les strates de pierre, de vie et de mémoire qui forment une épaisseur, réinventant à mesure les lois de son instable gravitation. Car si Paris semble devenir par instants une ville imaginaire, il faut dire qu’elle est avant tout une ville imaginative, voire jusqu’à un certain point mythomane (tous ces endroits où elle se prend pour Changai, Chicago, Conakry), sans cesse en quête d’elle-même sous le front rassurant que nous tendent les monuments de sa gloire. Sans doute redevable de ces dispositions aventureuses à la proximité de la mer (la lumière y est de sable et d’écume, l’air volumineusement libre et vert), peu à peu ses métamorphoses influent sur le promeneur. Il se pressent à son tour imaginé, promené comme l’antenne vagabonde et réflexive de la ville dans ses humeurs passagères (un coup de vent de carrousel d’automne au Luxembourg, un rayon qui, en un clin d’œil, porte à l’incandescence huit cents balcons de la rue de Grenelle), ou dans des lieux où, au contraire, elle peut céder au vertige d’une idée fixe (rue de l’Évangile, rue Leblanc), s’épanouir avec l’évidence d’une vérité bonne et majestueuse (l’avenue Parmentier, l’avenue Trudaine, l’esplanade du pont Alexandre et des Palais), et ailleurs répéter, parce que c’est instructif et nécessaire, la conclusion d’un raisonnement : telle, entre la Bastille et le fleuve, la vieille rame de métro qui, virant et grinçant, se réextirpait du sous-sol vers les nuages avec une placide régularité de geyser et une sourde véhémence axiomatique. »
Jacques Réda
Châteaux des courants d’air
Gallimard, 1986
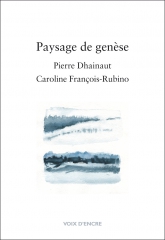
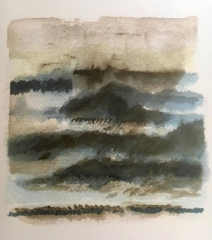








![Benoît%20Conord_web[1].jpg](http://www.unnecessairemalentendu.com/media/02/01/2078742023.jpg)

