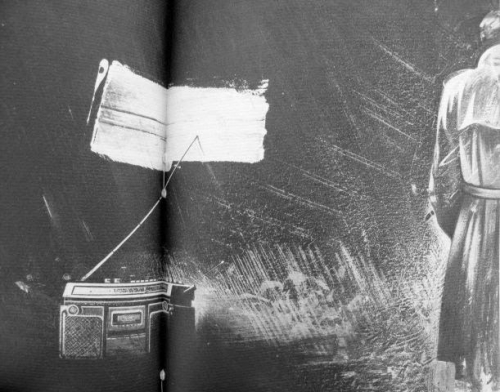Àlex Susanna, « Deux poèmes »

DR
« Nature morte
à Miquel Vilà
Sur la table reposent des livres,
des lunettes, un cahier, un crayon :
les instruments de quelqu’un qui a perdu
son temps à lire et à écrire,
à essayer de peaufiner quelque poème
où entrer et se reposer, ou bien se terrer dans son trou
après une journée plutôt morose…
Avant on trouvait encore des gens qui construisaient
des temples, et même d’imposantes cathédrales :
aujourd’hui nous nous contentons, la nuit venue,
d’une grotte, d’un abri quelconque
pour échapper à cet excès de mauvais temps
et cacher le froid qui par dedans nous ravage.
Sur le son et sur le sens
Il arrive que cette langue, la nôtre,
claque encore comme bois vert :
la verrons-nous brûler un jour
en silence comme ses sœurs ?
Tous ces crépitements, ces grésillements,
ces craquements, ces braillements à foison,
la danse de tous ses sons exacerbés
après tant d’années de prostration,
distrait et charme, excite même
mais finit par lasser :
dans le silence de la nuit,
lorsque d’une langue nous attendons
quelque chose de plus qu’une bonne musique,
nous voudrions arriver à entendre,
tout au fond de chaque vers,
le bourdonnement persistant d’une sobre
combustion, le lointain ressac
des jours à jamais perdus,
les brusques poussées des marées
qui trop souvent nous expulsent
de ce que nous croyons vraiment nôtre,
et tout l’enchevêtrement de courants
et de contre-courants d’un temps transformé,
plutôt qu’en un poulain écervelé
qui fuit sans savoir où il va,
en un coureur de fond
de plus en plus épuisé
qui revient constamment sur ses pas
pour voir si jamais il trouve la sortie
du labyrinthe où sans le vouloir
un beau jour il est entré par distraction. »
Àlex Susanna
Inutile poésie
Poèmes traduits du catalan par Bernard Lesfargues
Bilingue
Fédérop, 2001