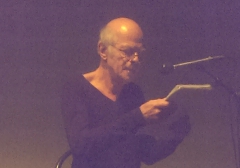Isabelle Baladine Howald, entre Sophie & Claude Chambard, été 1985, château de Bonaguil
« J’avais six ans, j’apprenais à lire, à écrire, de façon inséparable.
Je n’ai désormais plus jamais séparé ces deux choses.
Je lisais tout, le moindre panneau, la moindre affiche, la moindre enseigne, le dos d’une boîte, l’étiquette d’un produit, et les livres, tous les livres. J’ai lu tard des livres enfantins, et suis passée en un mois de temps à la littérature.
J’écrivais très mal, c’est toujours le cas —“Écriture impossible”, sur les bulletins ; ça ne m’a jamais arrêtée… J’avais trouvé un monde, le mien, silencieux, solitaire, d’où je n’émergeais que contrainte et forcée, à demi hallucinée, peuplée de fantômes.
Maupassant, dans un de ses livres, décrit son “éblouissement”, enfant, découvrant lors d’un mariage – il me semble –, en se glissant sous la table, “le bracelet de chair” entre le bas et la jarretelle de la jeune fille, tellement émerveillé qu’il dit avoir passé le reste de sa vie à la recherche de ce qu’il éprouva ce jour-là et qu’il n’a, bien sûr, qu’illusoirement retrouvé de temps en temps… C’est le sujet de tous ses livres : l’illusion perdue. L’écriture a de l’expérience érotique au moins cette approche de l’autre dont on ne fait que s’approcher. Mais l’autre, pas plus que l’écriture, personne, jamais, ne l’aura à soi.
La découverte de ce continent fut mon éblouissement à moi. Je passerai ma vie à rechercher cet instant et, parfois, parfois, éperdument reconnaissante, je m’en approche.
Je passerai ma vie à aimer les livres, à tout aimer d’eux, pas seulement les lire ou en écrire. J’aime les écrivains, les éditeurs, les libraires, les lecteurs ; j’aime les bibliothèques privées, plus secrètes que les publiques ; j’aime les textes ; j’aime m’occuper des livres, les ranger, les porter, les nettoyer, les couvrir, les dévêtir de ces affreux plastiques qui les isolent de l’air et des mains, les offrir, les annoter, regarder s’ils sont collés ou cousus (je les préfère cousus), prendre le coupe-papier… Il n’y a plus guère que les éditeurs de poésie à ne pas couper les cahiers des livres par avance. Il y a aussi un petit Beckett, L’Image, qui se vend mal, et dont le stock d’exemplaires non découpés n’est sans doute pas encore épuisé…
J’aime tous des livres. Le plus mauvais d’entre eux sera toujours bien traité ; j’aurai toujours du mal à l’imaginer mis au pilon.
Je m’épuise dans cet amour et, parfois, je désespère de tout ce que je ne peux lire.
Dans le jour qui se lève, on me trouve assise à écrire.
C’est sans doute pour retrouver la lisibilité des signes ou écrire le livre qu’à six ans j’ai cru voir. »
Isabelle Baladine Howald
in Soixante-cinq histoires de livres
Arléa, 2003
Recopier la page, pour souhaiter un bel anniversaire à Isabelle Baladine Howald – née le 25 mai1957.