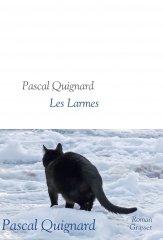Ludwig Hohl, « Notes »
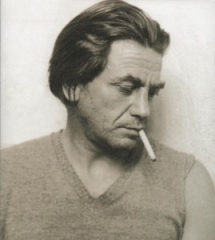
DR
« L’écriture n’est qu’une intensification de la lecture, et la lecture seule donne la vie à l’écriture. Ceux qui opposent ces deux activités n’ont rien compris aux livres. Ils n’ont jamais lu, jamais soupçonné ce que lire signifie.
(“Lire dans un état de réceptivité souffrante” : on peut recevoir de l’argent dans l’indifférence ; mais non point la connaissance, ou quelque bien intérieur de même nature.)
Pourquoi lit-on passivement ? Cette erreur s’explique d’abord par une méprise sur la nature de la création. Nous voulons bien que l’écriture soit créatrice, disent les gens, mais la lecture c’est le contraire, puisqu’on n’y fait rien, puisqu’on se contente de récolter ce qui est déjà là. Ainsi donc, la création serait un coup de baguette magique, un pur surgissement, la métamorphose du rien en quelque chose ?
Tout est déjà là ; mais pour l’obtenir
L’art est nécessaire ; et qui peut y parvenir ?*
Ceux qui écrivent, n’ont-ils pas les mots ? Bien plus, n’ont-ils pas derrière eux des millénaires de grammaire éprouvée ? Mieux encore : toutes les pensées formées par des générations antérieures, et la possibilité de les moduler, eux qui sont environnés de forces et traversés de vie ? Ils n’ont rien d’autre à faire qu’à choisir ! La seule différence entre l’écriture et la lecture, c’est que les choix de cette dernière sont plus limités. »
* Goethe, Faust
Ludwig Hohl
Notes ou de la réconciliation non-prématurée
Traduit de l’allemand par Étienne Barilier
L’Âge d’homme, 1989

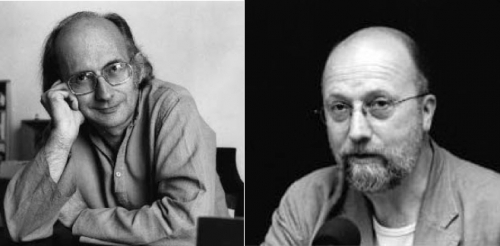




 Maurice Darmon
Maurice Darmon