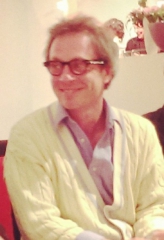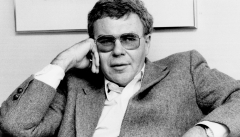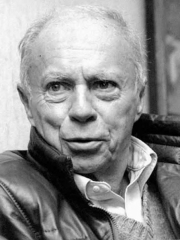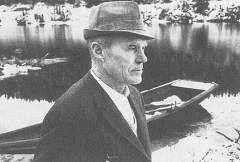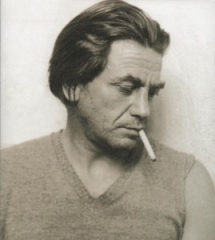Nicolas Pesquès, « La face nord du Juliau »
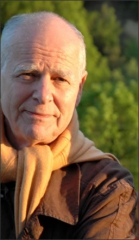
DR
« Le 1er août
Ceux qui peignent, écrivent, sculptent etc. se présentent côte à côte, devant le monde. Ils sont les constructeurs d’un chassé-croisé, d’un ombrage pluriel. Ils procèdent par trouées et hybridations. Ils dressent des murs jaunes, des phrases. Ça prend forme. Ça meurt. Ça.
Ce qui les rapproche : la constance de l’action, la sécession. Les profondes dérivations de chaque geste, de chaque pas. Greffe et marcotage. Bientôt les frondaisons et l’ombre de chacun. Bientôt les disparus qui ne se ressemblent plus. La dissidence des corps, l’intrigue des généalogies.
Les fonctions sont nombreuses : tropes, images, souvenirs, afflux de toute espèce.
Dans l’affolante émulsion de tout ce que l’on voit.
Peindre ce qui ne se voit pas : l’air, la lumière, les peindre sans que ça se voie.
Peut-on remplacer peindre par dire ? »
Nicolas Pesquès
La face nord du Juliau – treize à seize
Poésie/Flammarion, 2016