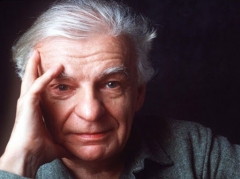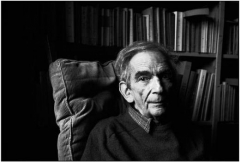Franck Venaille, « La bataille des éperons d’or »

© Jacques Sassier
« L’EAU
des tourbières
l’eau où mon règne perdure
avant de glisser ce qui me reste de voix dans la fanfare
et
d’en être le speaker jamais abattu
l’eau
m’attire – tire – cette eau
j’ai bien connu le bourgmestre
il faisait apparaître la ligne d’horizon
souris – mulots – hérissons – taupes
devinrent mes amis ces années-là
où je fus désigné fournisseur en eau potable pour récitals il
faut être celui-ci qui bouleverse la salle entière
ainsi
la poésie un jour fermera boutique
laissera une dernière fois ses rideaux métalliques
comme cela fera chic et bon genre
J’ai délaissé mon Palais d’enfant. J’ai vécu loin des canaux. Ailleurs. Face à la mer du Nord. J’ai écrit des livres. Il a encore fallu se battre contre les chars venus de Prusse. Je savais que par milliers, les tourbières m’attendaient. Certaines d’entre elles, depuis, je ne sais pas, moi, disons l’acte officiel attestant de la naissance chez le charpentier d’un enfant de sexe mâle dénommé comme déjà ? Jésus. Mais les tourbières souffraient-elles du froid? Quel était, oui quel était le meilleur angle pour tenter de pénétrer dans ce qui ressemblait au souterrain quasi secret du château d’Allemonde. Mais qu’entendait-on ? Des respirations irrégulières d’un soldat sommeillant durant ses heures de garde, c’est le destin des hommes qui m’attire. J’aime savoir. Quoi ? Ce qui se passe derrière les apparences. Le plateau attendait la fonte des neiges. D’énormes blocs de glace s’étaient rassemblés. De grandes dépressions se formèrent. J’avais quoi ? L’enfance mauvaise. Pourtant j’apprenais avec cœur le nom des rivières ici nées : la Sauve, la Gileppe, la Soor, la Helle. Mais voir les arbres combattre, pliés par le vent, perdre feuilles et branchages : comment supporter cela ? »
Franck Venaille
La bataille des éperons d’or
Mercure de France, 2014