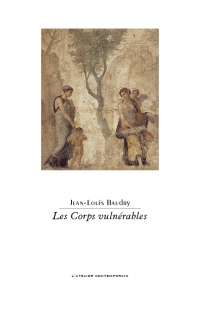« Avec son faux argot soldatesque, De Gaulle eut un soir la trouvaille d’amuser la galerie en stigmatisant mai 68 (qui ne l’a pas amusé une seconde) sous le nom de chienlit.
Peu soucieuses d’étymologie, les classes moyennes s’en tinrent alors au signifiant, sans voir, que, comme d’habitude, l’aigreur rendait à la langue sa vérité.
La chienlit, c’est le nom que les enfants et les gens du peuple (les enfants et les gens du peuple ! cher Littré... ) donnent aux masques qui courent les rues pendant les jours gras.
C'est qu’il s’agissait bien de masques et de jours gras.
C’est cela qui blesse aujourd’hui le pétainisme aux commandes, voulu, et programme sa haine malade des désirs. Pétainisme, Vichy, chienlit, mais de quoi parle au juste la langue...
L’atomisation des corps et des désirs perdus oblige à inventer une morale. Morale du geste, de la mémoire, de la langue qui passe, morale absolue de la langue et morale à la recherche d’un communisme de pensée (Mascolo).
On l’appelle morale, c’est plutôt une bonne nouvelle.
Comment se fonderait-elle à l’écart du seul exercice qui relève encore d’une autonomie relative, celui de la littérature ou de la musique...
Ce que l’échange en temps réel – information, bourse, communication – perd de différence, il ne pourra la recréer que dans un lointain à trouver. Ce lointain est la seconde attente sensible.
C’est de cela que les Lumières des années 60 (mai 68 en France), bouleversant avec de légers délais l’ensemble du champ de la connaissance et de l’action (sémanalyse, politique, musique, peinture, littérature), mais aussi la façon de vivre d’amour, précédées par la musique comme autant de signes avant-coureurs (Ornette Coleman, Jimi Hendrix, Albert Ayler), affichaient sans le savoir la prescience.
La morale sociale des familles n’a pas suivi. Question de peur de l’inconnu et de méchanceté pure.
Les camps nazis ont fixé la forme définitive, excellente (cela n’eut rien d’une erreur), parfaite, d'une société attelée sous le joug de bourreaux de travail (de très gros travailleurs...) qu’animaient les meilleures intentions.
L’explosion heureuse d’une génération qui put ici en finir avec la compromission accablée de ceux qui n’ouvrirent péniblement les yeux qu’en 1945, en finir avec les innocents manipulateurs de gégène dans le vent des Aurès, avec le napalm des pacificateurs, a simplement eu le sens d’une révolution sans mortelle dérive contre l’ennui mortel.
Sait-on de quoi l’on s'ennuyait avant les vacances de mai ?
L’ennui est revenu. Il est très désœuvré. À la volonté morale alertée par l’amnésie, la soumission et le mensonge ventriloque, se joint l’attente de jouissances qui n’aient rien de guidé.
La perfection du malheur, on y est allés, tous, en rangs plus ou moins serrés.
La perfection du bonheur, nul n’a plus besoin d’y courir, parce que l’on se fie encore moins à l’idée de bonheur qu’à celle de perfection.
Restent à trouver les notes d’une allégresse intime qui ne soit que la forme vivable du monde et de son désespoir. »
Francis Marmande
La perfection du bonheur
Descartes & Cie., 1994