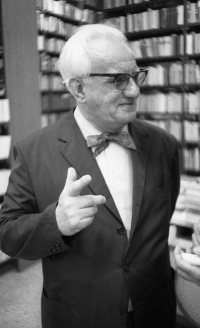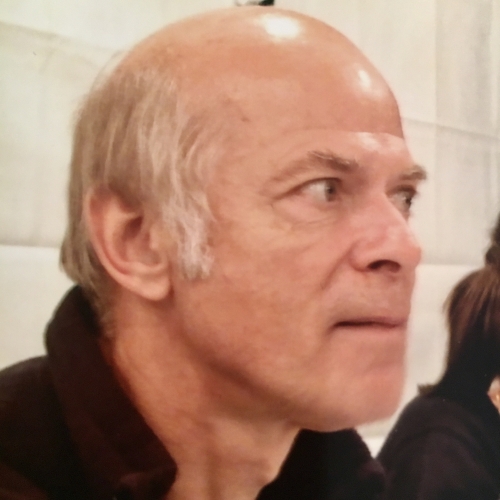« De l’art s’esquiver, même si l’art s’esquive lui-même autant que l’hippocampe de la mer s’esquive à paraître indifférent, non, discret, distrait peut-être ?
Cheval du jeu, échec ou roi roux, l’hippocampe, ange ambigu des eaux, se sauve jouant la diagonale. Racé, il survole les cases, les évite en vrai dandy des mers. On ne sait de quel petit monstre il garde élégance et silence. Il a l’élégance de l’esquive.
L’esquive, avec cette élégance vers la grande inconnue serait pour le dévoilement d’un coup. Mais pourquoi la plus courante des choses sous le banal des jours, émerveille-t-elle tout à coup ? C’est l’émerveillement subit, même devant le plus connu, celui que nos mères nous montraient sur le Pont le long du quai.
Tout balayer avec la gomme idéale, arrêter ce qui hurle et garder le sacré du silence, son dieu Harpocrate, distiller là où le temps n’a prise, miniatures et riches heures. Concentrer le tir vers un point mental sur échafaudage.
Garder l’émotion sur le fil, sur la colonne de Siméon, funambule sur le fil. Y retrouver l’attention du moine peintre d’icônes.
Le funambule de l’à-peine, inscrit pour ces instants qui tentent de voir un brin d’affinement de quelque lumière, tandis que les siècles d’art traversent, poussant ces instants.
Faire des lignes une seule, au plus juste, que des couleurs aiguisent pour attiser la paix partant du corps et arriver à la paume.
La ligne de cœur,
ligne du vif,
se précise,
s’aiguise,
s’incise
arrive
au fil
fin.
La très jeune femme est déjà là, dans ce fil. Ses sandales fines glissent sous cette porte, les chevilles maigres à peine touchées par le bas d’une robe de soies légères.
Le grand marin l’a-t-il vue, tant emmêlé dans ses siècles.
D’un siècle l’autre, toujours quelques péripéties pour attraper le ciel.
Embarqués dans une époque qui se cherche, toujours au bord d’un vaste cassage de gueule, où se niche le ciel à vif sur les rues, les forêts et les sables ?
La pudeur dit en sourdine, dit en force, préserve, protège encore cet amour formidable qui fait la vie, la suscite, la relance. En sourd, discrètement farfelue, un peu silencieuse une émotion qui mine de rien est le fond des sentiments qui continuent à se tisser sur les tables en silence pour tenter d’inscrire du léger.
C’est l’assis face au debout, l’à peine face à l’époustouflant, ce qui se tait face au criard.
Le bruit n’effacera jamais le murmure continu plus ténu sur les tables. Des fusées ne s’en échappent pas, mais en monte une lumière qui retient du feu.
A travers des régions malhabiles, des trappeurs moins aguerris continuent à grimper mains nues les roches plus arides.
La question ouverte infiniment conjuguée et s’articule.
La poser point à point en brodeur qui compte, le faire plus que le dire, à la pointe du crayon.
Dire met sur la pointe.
Tenter d’inciser ce cela même qui peut animer l’instant d’un petit air d’éternité, a cet air fin là, même s’il n’est que dans la tête.
Les portraits sur fond cæruleum intense de Cranach
restent suspendus du côté du cour qui s’en fend.
Il y a plus, encore plus dans ce que l’on ne sait.
À travers ce fichu trajet qui nous y amène, s’engrange une pyramide d’émotions.
On fait son tour, toujours à court,
on repart plein, grelottant.
Né nu, on repart nu.
Une part ineffable va où elle ne sait, ouvre de l’inconnu limpide. Le face à face avec le papier, plage de blanc un peu ivre, plonge sans mémoire pour défricher ce qui bouge de vent dessous.
Les décalés du temps, s’évadent en connivence avec les siècles, dans la lisière, large plaie blanche de sable, longue plaie le long des murs qui traverse le fil de l’histoire des villes.
Eux sautent ces murs de la honte.
Aller dans le brut de briques délitées, salpêtre érodé, poussières, pentes de cendre d’où l’on ne redescend, vers l’impalpable du bleu joyeux par là-bas, vers les chants d’un orchestre malhabile. »
Jeanne Gatard
Laps
Tarabuste, 2020
https://www.laboutiquedetarabuste.com/doute-b-a-t-poesie.b/s419819p/Jeanne-GATARD-Laps