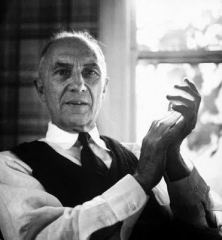Miklós Szentkuthy, « Vers l’unique métaphore »

DR
« Combien atroces, étourdissants que ces trois mondes : quelqu’un a proximité travaille son piano à un rythme forcené ; je lis un roman ; je médite sur mon sort, sur mes infirmités. La musique, techniquement, est presque parfaite : les touches s’envolent du corps du piano comme les perles d’eau d’une fontaine — c’est la statue de la santé, du non-étourdissement, de la limpidité sans scrupules des éléments, de l’étincelante fitness, du travail objectif, du progrès inconscient de la mort, de la beauté matérielle barbare et de l’accord positif enfantin. En contraste si absolu avec l’état présent de mon corps et de mon âme, qu’on ne saurait les imaginer si proches, se côtoyant sur terre. Le livre est plein de mysticisme de terreurs au goût freudien, de superstitions, d’insectes, de mythes sanglants et de poésie anglaise d’amours printanières “ambigües”* — en un mot, plein d’une douleur et d’une incertitude abyssales ; mais cette imprécision chaotiquement mouvante n’en est pas moins déjà formulée, élevée au rang d’œuvre ; heureux désespoir et préparation à la mort, capables de se donner une forme aussi classique. Et pour finir, moi : tout simplement constitué des formes plastiques et des rédemptions du strabisme, de l’étourdissement, du bégaiement, de l’obscurité et de la nausée, d’une hypochondrie sourde et bourdonnante, d’un Dieu lointain, d’amour, de l’œuvre — informité de la souffrance, imbécile guenille sans poésie, sans désirs, sans révoltes. »
* en français dans le texte
Miklós Szentkuthy
Vers l’unique métaphore
Traduit du hongrois par Eva Toulouse
Coll. « En lisant en écrivant », José Corti, 1991