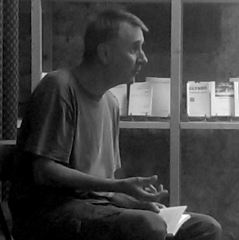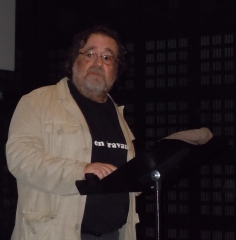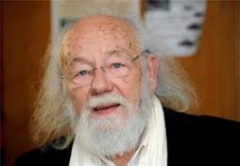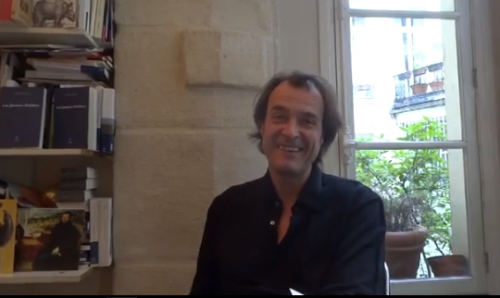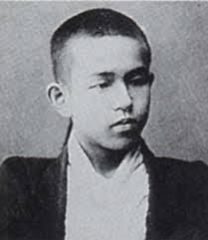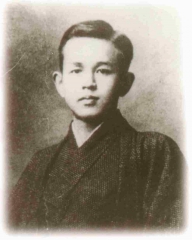Roland Barthes, « Journal de deuil »

« 30 octobre
À Urt : triste, doux, profond (sans crispation).
10 novembre
Gêné et presque culpabilisé parce que parfois je crois que mon deuil se réduit à une émotivité.
Mais toute ma vie n’ai-je été que cela : ému ?
30 novembre
Ne pas dire Deuil. C’est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil. J’ai du chagrin.
27 décembre 1977
Urt.
Crise violente de larmes.
(à propos d’une histoire de beurre et de beurrier avec Rachel et Michel). 1) Douleur de devoir vivre avec un autre “ménage”. Tout ici à U. me renvoie à son ménage, à sa maison. 2) Tout couple (conjugal) forme bloc dont l’être seul est exclu.
24 mars 1978
Le chagrin comme une pierre…
(à mon cou,
au fond de moi)
Vers le 12 avril 1978
Écrire pour se souvenir ? Non pour me souvenir, mais pour combattre le déchirement de l’oubli en tant qu’il s’annonce absolu. Le – bientôt – “plus aucune trace”, nulle part, en personne.
Nécessité du “Monument”.
Memento illam vixisse.* »
Roland Barthes
Journal de deuil
Seuil/Imec, 2009
* Souviens-toi que celle-là a vécu.