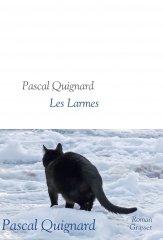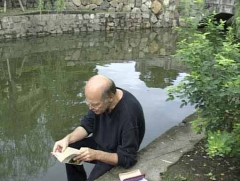François Dominique, « Tournoyer avec Roger Laporte »
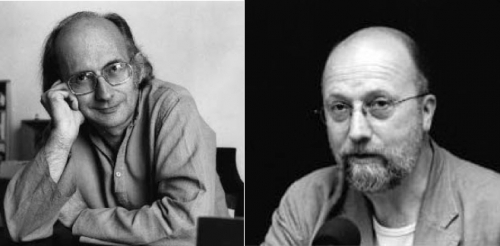
Roger Laporte & François Dominique
« La lecture de Une vie, biographie est censée nous révéler (non au sens mystique, mais comme la révélation d’un négatif en photographie) qu’une certaine modalité d’ÉCRIRE permet d’accéder, non pas au monde du vivant en général, mais à la forme de vie générée par l’écriture. Pas même le Christ, qui n’a jamais écrit durant sa courte vie qu’une seule phrase sur le sable, n’envisageait la vie, précaire ou éternelle, comme le produit de l’acte d’écrire… et les “Écritures” des apôtres n’ont jamais prétendu être une sorte de “Le Livre s’est fait chair”, Roger Laporte, lui, démiurge ou Don Quichotte, n’envisage que cela : écrire pour accéder à “une” vie suréminente : “J’irai de ce côté, jamais d’un autre”. Alors ? “Folie d’écrire”, comme le disait Blanchot parlant de Hölderlin, de Kafka et de… Laporte (article de Libération, 6 mars 1986) ? Oui, mais patience…
Au lecteur de relancer les dés et la mise, de voyager à ses frais, d’explorer à ses risques et périls. À cet égard, Une vie, biographie s’inscrit comme un jalon sur un parcours dont le terme n’est jamais fixé par avance. Ainsi, Roger Laporte écrivait dans Fugue – Supplément, en 1973 :
Appeler Biographie un ouvrage qui pourtant ne relate rien de ma vie d’homme comme telle, où il est seulement question d’écrire, c’est affirmer qu’une certaine vie n’est ni antérieure, ni extérieure à écrire, qu’on ne saurait donc connaître cette vie-là autrement qu’en écrivant. Biographie n’est donc pas un pur contenu : même ce mot, surtout ce mot, n’a tout son pouvoir qu’en liaison concrète avec ce qu’il implique : la vie économique de l’entreprise littéraire. Je crois que toute consommation passive de l’ouvrage que j’écris est impossible ; j’ose espérer que sa lecture, loin d’assouvir l’appétit, éveille le désir d’écrire et, à la limite, j’aimerais que cet ouvrage soit seulement scriptible, tel donc que seul un scripteur, du moins virtuel, puisse en faire la lecture.
Dix ans plus tard, la même exigence s’affirme, avec la plus grande concision, dans Moriendo : “Poursuivre – Poursuivre : silencieuse injonction à laquelle plus tard d’autres répondront.”
Il ne s’agit évidemment pas de susciter des zélotes ni des épigones : voilà ce qui pourrait arriver de pire à une œuvre de cette envergure. Je veux seulement dire que, nous autres, en qualité de lecteurs, ne sommes pas seulement tenus par l’amitié ; nous devons observer la façon dont le texte agit sur nous, dans une dynamique : vivre-lire-écrire-vivre… »
François Dominique
Tournoyer avec Roger Laporte
Fata Morgana, 2016