Jean-Claude Pirotte, « Le Silence »
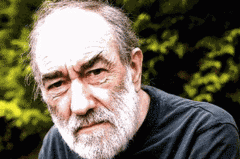
DR
« Je dirais : allant de cave en cave je me suis aperçu que je n’avais pas besoin de le boire pour aimer le vin. Je l’aimais déjà, je l’aimais avant de le goûter, je l’aimais avant de le connaître, je l’aimais avant de naître, je l’aimais avant que les poètes m’apprennent à l’aimer, je l’aimais avant que l’homme se décide enfin à cultiver, apprivoiser, choyer la vigne comme un trésor inespéré. Je l’aimais avant de savoir que la vigne porte des fruits, avant même que l’homme s’en avise, avant que je trouve une grappe au fond d’une combe et que je la goûte, je l’aimais comme un paysage rêvé, je l’aimais comme un songe et je l’ai détesté comme un cauchemar. Je l’aimais avec la ferveur que je veux éprouver plus tard pour la femme que j’espère aimer. Je l’aimais avec la pudeur que j’imagine être celle des amants courtois, oui, j’aimais le vin comme le troubadour chérit sa Dame – sans la connaître. J’aime donc le vin parce que je ne le connais pas, et que jamais je ne le connaîtrai.
J’aime le vin parce qu’il m’est étrange, parce qu’il m’est familier, parce qu’il est incompréhensible et fabuleux. J’aime le vin parce que je ne peux m’empêcher d’aimer les hommes.
J’aime le vin que je bois, lorsqu’il mérite son nom. Dans ma cave, il n’y a pas de vin. Il n’y a que d’heureuses espérances. De troublantes expériences. Ma cave est ce fond de caveau que me concède Marius. Je m’y glisse comme au confessionnal, ou pour prier dans une chapelle perdue, ensevelie, où le secret sacramentel est gardé par l’araignée et le champignon. Dans la cave des prétendus amateurs, il y a une collection de bouteilles. Dans les coffres de banques, il y a des valeurs, qui sont des flacons que l’on déshonore. Les déboucher, se serait constater que le vin se révolte. Le vin, c’est le ferment de l’émeute. Le comble de l’esprit d’insurrection, de civilisation. L’alcool de vin, marc, fine, c’est le sommet de l’expérience mystique.
Comment pourrions-nous oublier que l’eau se change en vin ? Oublier que la rose et la vigne sont les ornements du jardin d’Allah ? Comment oublier que le fruit conserve et magnifie la nourriture et la boisson de l’éden – cet éden où nous vivons (si nous le voulons), car nous n’en avons été chassés que pour nous y installer par goût du paradoxe, et passion de la transgression.
Chaque jour nous réinventons l’éden avec nos cornues d’alchimistes, avec nos pressoirs et nos cuves, avec nos tonneaux et nos tastevins. »
Jean-Claude Pirotte
Le Silence
Préface de Philippe Claudel
Stock, 2016










