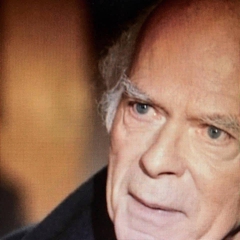DR
Air : “Poisson attrappé”.
L’année jihai de l’ère Chunxi, je fus muté comme commissaire de circuit du Hubei au Hunan. Lors d’une fête que je donnai avec le fonctionnaire Wang Zhengzhi dans le pavillon de la petite montagne, je composais ces paroles :
Combien d’orages encore pourrais-je endurer ?
À toute allure, le printemps s’est de nouveau enfui.
Je chéris tellement cette saison que toujours crains les fleurs trop tôt écloses,
Et pire encore leurs rouges pétales qui choient innombrables.
Printemps, demeure encore un instant !
On m’a dit que dans les herbes parfumées aux confins du ciel, tu perds le chemin du retour…
Ah ! Pourquoi ne dis-tu rien ?
Seule une araignée, ce me semble, s’affaire
À tisser sa toile sous l’avant-toit peint
Et tout le jour séduit les chatons envolés…
Tant d’histoire autour de la Grande Porte !
L’heureuse rencontre tant attendue encore déçue ;
Mes yeux de papillon les ont rendus jaloux !
J’aurai beau payer de mille onces d’or la rhapsodie de Xiangru*,
Mon doux et long amour, à qui pourrais-je le dire ?
Seigneur, ne danse pas !
Ne vois-tu pas les belles, Anneau de jade, Aronde en vol** – poudres et poussières !
Nulle souffrance plus grande que d’être oisif et seul…
Ne va pas t’appuyer dans de hauts belvédères :
Le soleil couchant est juste là
Où se brise mon cœur dans ces saules embrumés ! »
* Allusion à la « Rhapsodie de la Grande Porte » composée par Sima Xiangru à la demande de Dame Chen, épouse de l’empereur Wu, assignée au palais de la Grande Porte après avoir perdu ses faveurs
**Anneau de jade et Aronde en vol : surnoms de Yang Guifei, favorite de l’empereur Xuanzong des Tang, et de Dame Zhao, épouse de l’empereur Cheng des Han antérieurs, remarquée pour ses talents de danseuse.
Xin Qiji (28 mai 1140 – 1207)
In La dynastie des Song du Sud
Traduit du chinois par Stéphane Feuillas
Anthologie de la poésie chinoise
La Pléiade/Gallimard, 2015