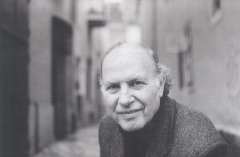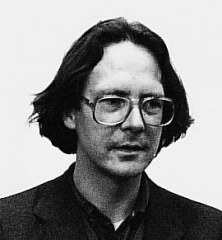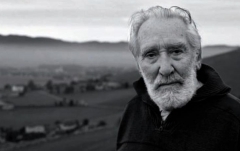Michael Ondaatje, « Le grand arbre »

Zou Fulei, Un souffle de printemps, 1360
« Zou Fulei est mort comme un dragon abattant un mur…
ce vers composé et enrubanné
d’une écriture cursive
par son ami le poète Yang Weizhen
dont le père bâtit une bibliothèque
entourée de centaines de pruniers
C’était Zou Fulei, presque inconnu,
qui faisait les plus belles peintures de fleurs de pruniers
de tous les temps
Une branche dressée dans le vent
et la ligne verticale des caractères de son ami
leurs couleurs d’encre
– de délavé à opaque
de sombre à pâle
chaque mouvement et chaque geste
appris et différent
renvoyant à l’art de l’autre
Dans la haute bibliothèque entourée de pruniers
où le jeune Yang Weizhen étudia
on retira l’escalier mobile
pour assurer sa concentration solitaire
Sa grande œuvre
“libre” “originale” “non conformiste”
“sans trace de superficialité”
“sans mouvement flamboyant”
utilisant parfois les queues recourbées
de l’écriture archaïque,
partageant avec Zou Fulei
ses bonds et ses obscurités
*
Ainsi je t’ai toujours gardé dans mon cœur…
Le grand poète calligraphe du XVIe siècle
pleure la mort de son ami
Le langage attaque le papier depuis les airs
Il n’y a qu’un chemin semé de fleurs
pas de mouvement flamboyant
Une nuit d’encre noire en 1361
une nuit sans escalier »
Michael Ondaatje
Écrits à la main
Traduit de l’anglais(Canada) par Michel Lederer
Bilingue
L’Olivier 2000, rééd. Points Seuil, 2019