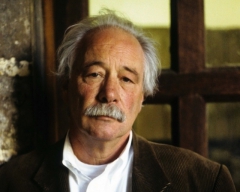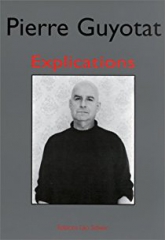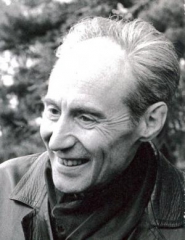DR
La vieille femme
Aujourd’hui je suis malade, et demain je serai guérie.
Aujourd’hui je suis pauvre, aujourd’hui seulement, et demain je serai riche.
Mais un jour, je resterai toujours assise ainsi,
Blottie, grelottante, dans un châle sombre, la gorge qui toussote, se racle,
Je me traînerai péniblement jusqu’au poêle en faïence où je poserai mes mains osseuses.
Alors je serai vieille.
Les sombres ailes de merle de mes cheveux sont grises,
Mes lèvres des fleurs séchées, poussiéreuses,
Et mon corps ne sait plus rien des cascades et jaillissements des fontaines rouges du sang.
Je suis morte peut-être.
Bien avant ma mort.
Et pourtant j’étais jeune.
Étais aimante et bonne pour un homme comme le nourrissant pain doré de sa main affamée,
Étais sucrée comme un réconfortant à sa bouche assoifée,
Je souriais,
Et les enlacements de mes bras de vipère mollement enflés attiraient dans la forêt magique.
Et à mon épaule bourgeonnait une aile bleue comme de la fumée
Et j’étais allongée contre la plus large poitrine broussailleuse,
Murmurant vers l’aval, une eau vive jaillissait du cœur du rocher aux sapins.
Mais vint le jour et l’heure vint
Où les blés amers se trouvèrent mûrs, où je dus moissonner.
Et la faucille coupa mon âme.
“Va”, dis-je, “Amour, va !
Regarde ma chevelure agite ses fils de vieille femme,
Le brouillard vespéral déjà humecte ma joue,
Et ma fleur d’effroi se fane dans les frimas.
Des rides sillonnent mon visage,
Des rigoles noires les pâturages d’automne.
Va, car je t’aime beaucoup.”
En silence je retirai la couronne d’or de ma tête et me voilai la face.
Il partit,
Et ses pas apatrides l’emportèrent sans doute vers une autre halte sous des pupilles plus claires.
Mes yeux se sont brouillés et c’est tout juste s’ils passent encore le fil dans le chas de l’aiguille.
Mes yeux pleurent fatigués sous les paupières lourdement plissées, au pourtour rougi.
Rarement
Dans le regard éteint point de nouveau la faible lueur au loin enfuie
D’un jour d’été,
Où ma robe légère, ruisselante, inondait les champs de cardamine
Et ma mélancolie lançait dans le ciel béant
Des cris d’allégresse d’alouette. »
Gertrud Kolmar
Mondes (1937)
Bilingue. Édition établie, postfacée et traduite de l’allemand par Jacques Lajarrige
Coll. Autour du monde, Seghers, 2001