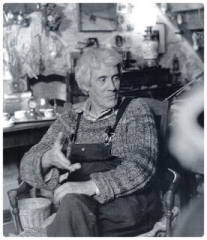Jude Stéfan, « Aux poètes »

DR
« Chers collègues,
car d’eux d’entre nous sont déjà morts, comme nous disons en notre langage d’aveugle, morts autrement que nous, Salabreuil, Perros, j’eus de l’amitié pour eux, de la reconnaissance, de l’estime pour d’autres – mais que recouvrirait le terme impossible d’“ami” ? Qu’est-ce que la poésie en ce moment pour moi, pour nous, en partage ? On connaît la chanson : on apprend la mort effective par suicide, vieillesse ou cancer, à trente ou cinquante ou quatre-vingts ans du poète X qui avait publié trois ou cinq – c’est meilleur signe – ou cinquante recueils remarqués des trois cents amateurs parisiens ou étrangers : alors peut-être on fouillera dans ses traces pour trouver quoi ? de la vie, mais lui, l’était, la vie, peut-être, lorsqu’il y était, en elle. Entretemps comment donc avoir vécu, sans ou avec la poésie ? Vivre est un fait de prose et qui se suffit à soi-même : manger, dormir, marcher, parler, lire des journaux. On écrit à défaut, ou en outre, ou à côté de la poésie qu’on épouse parfois dans l’enfance, l’effusion corporelle, des instants de voyage et qui restent, la joie de disparaître. Il y a un désastre de la poésie des années 60-80, dont quelques rocs, quelques noms commençant par D. ou R. témoigneront aux mains des béats successeurs, tous les bricoleurs actuels – électriciens ou concasseurs, étoileurs de pages, aussi les éternels vieux sentimentaux radotant leurs émotions, ou les asphyxiés du verbe – eux, oubliés de leur vivant même, pâlis, effacés, dépassés. Or je ne suis pas de ceux qui continuent et mes vers ne dureront pas plus ni moins que ceux d’un “écrivant” : honteuse justification ! Non, une tombe gravée sera notre seul poème vrai : on s’incline, on lit enfin avec respect les dates et les noms. Certes on écrit - vit - aime ; je ne dissocierai pas ma mort de mes cris vifs; il n’est aucune poésie dans la naissance, cette expulsion au champ du pire, ce miracle pour sages-femmes et bêtasses – mais elle est tout ce qu’on invente après-coup, malade d’un désir. J’ai écrit de faux vers, parfois de beaux à l’ancienne, la métrique est pour les professeurs. Il nous faut être debout, nous chausser, nous savoir, croire en tel siècle : rude courage ! La poésie (re) commencera grâce à des gueux artisans sensibles qui n’auront pas plus la pudeur de se taire, on recommencera l’effort de Rimbaud et Denis Roche, par comble ! Un “jeune” poète aura toujours quarante ans. Souvent je suis dans l’impensé, ayant honte d’avoir vécu inacceptable, incapable de savoir quoi se rate dans l’usage de la langue, pris dans l’inguérissable manie de raturer le sens qu’on a mis partout, dans les cités, les rapports humains (il n’y en a que de sexuels), les destins, à me voir incapable de dormir innocent de mes rêves, à devoir deviner qui je marche, qui je suis, qui je parle. Donc je suis : c’est la conclusion; or ce n’était que le commencement. Heureusement l’univers n’a pas de sens, ni la mort, ni la nuit, ni la beauté, ni l’amour, ni donc la poésie. Oui, c’est vrai, je n’aurais voulu écrire que par tout cela effaré, si seul écrire me guérissait de moi-même. »
Jude Stéfan
Lettres tombales (ad familiares)
Le temps qu’il fait, 1983
http://www.letempsquilfait.com/Pages/Pages%20auteurs%20A-Z/Page%20auteurs%20S.html