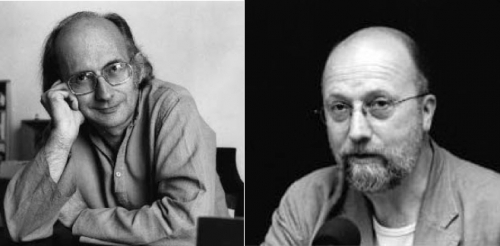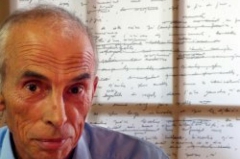Dušan Matić, « Chambre d’hôtel »

« Au cours de la nuit un homme se réveille, soudain, dans une ville inconnue, dans une chambre d’hôtel inconnue. L’homme entrouvre les volets de la fenêtre. La nuit est paisible.
Des pas inconnus.
Pour la première fois, l’homme se voit autre : inconnu.
D’où lui vient ce corps ? La nostalgie qui l’accompagne ? Les passions ? L’homme allume la lampe. Il contemple son corps. C’est la première fois qu’il voit ce corps. Il marche. Il voit son ombre sur le mur.
En quel lieu ? ce personnage ? ce corps ? ces souvenirs inconnus de lui ? ces pensées ? sa stupeur ? Où descend-il maintenant ? N’est-il pas le témoin inconnu, de ces pas, de sa propre chute ?
Plus un bruit.
L’écho des pas inconnus se fait entendre à nouveau. Qui portent-ils ? Où se presse celui qui marche ?
L’homme retourne à ses souvenirs. Aucune trace de souvenir. Ils sont vides, vidés – flacons vides qui auraient pu (qui auraient dû) être pleins. Qui détient l’eau potable du souvenir ? Ne reste-t-il que ces formes vides ?
Seule est réelle cette obscurité autour de lui, autour des souvenirs, autour de ce corps inconnu.
Qui habite ce corps ? Les passions, celle de la nuit d’abord, puis les autres, passions dévorantes qui disparaissent, sitôt présentes. Que faut-il faire ? Que doit-il faire pour éteindre ce feu, celui des souvenirs, des pensées, le feu insatiable des passions.
Au-dehors, le bruit des pas a cessé. C’était donc lui-même celui-là qui marchait sous la fenêtre. Où courait-il ? Pourquoi fuir ? Fuir cette ombre sur le mur, ce corps.
De nouveau, les pas.
Qui donc à son réveil imagine cet inconnu ? Pourtant, l’homme est sans besoins, sans désirs, absent. Où situer cet impossible passé : la vie ?
Ne pas aller jusqu’à cette ombre, là, sur le mur. Ne pas croire à ses pas, à ses désirs, à ses passions, à cette lampe qui le projette là, sur le mur.
Quels témoignages ? Que faire de celui qui ne peut ni ne sait plus dormir ? que faire de cette impitoyable renaissance ?
Sur la rive enfin déserte, il “est” à peine ce corps, cette ombre esquissée, aussi intouchable que son corps, lointaine, qui disparaît dans ce lieu qu’il ne peut ni ne veut circonscrire. À chaque nuit, pour chaque réveil, le démon de sa nuit – plus et moins qu’un homme, plus et moins qu’une ombre. Et ce dernier même, il ne le hait point.
Pour la première fois, l’homme s’est à lui-même apparu – ombre incertaine, l’ombre d’un rêve. Semblable à cette voix, en lui, en moi, proche de moi, la voix d’un autre, en tous cas.
Cela, je l’ai compris tout de suite.
Toujours ce masque, sur le visage, collé à ses tempes. Je marche, porteur de ce masque – et, chaque fois, un masque différent qu’il ne reconnaît pas. […] »
Dušan Matić,
« Chambre d’hôtel »
La porte de nuit – songes et mensonges de la nuit II
Traduit du serbe par André Dalmas
Illustrations de Gérard Titus-Carmel
Fata Morgana, 1973