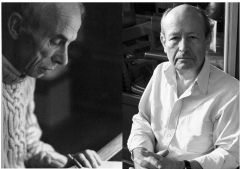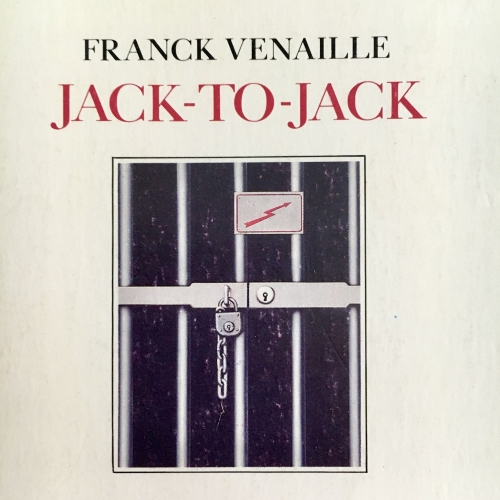Luis Cernuda, « Ombres »
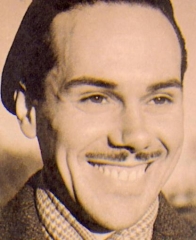
DR
« Ombres
Il était blond et fin — avec un visage d’enfant, ajouterais-je, si je ne me rappelais ses yeux bleus, ce regard de qui a goûté la vie et l’a trouvée amère. Au poignet de sa manche, rouge comme une blessure fraîche, il portait un galon de caporal gagné au Maroc d’où il venait.
Il était sur un char et déchargeait des bottes de paille dorée pour les chevaux qui, impatients à l’intérieur, logés comme des monstres infernaux sous d’énormes voûtes obscures, blessaient les pierres de leurs sabots en secouant les chaînes qui les maintenaient à la mangeoire.
Son air distant et absorbé, dans l’humilité de sa tâche, rappelait le jeune héros d’un récit oriental qui, chassé du palais familial où tant d’esclaves veillaient à satisfaire ses moindres désirs sait se plier à leur travail, sans perdre pour autant sa grâce altière.
*
Il passait au crépuscule, petite tête ronde aux courtes boucles noires, bouche fraîche où s’ébauchait un sourire moqueur. Son corps agile, fort et harmonieux, rappelait l’Hermès de Praxitèle, un Hermès qui eût porté sous son bras replié contre la hanche, au lieu de Dionysos enfant, une énorme pastèque, l’écorce verte et obscure toute veinées de blanc.
*
Ces êtres dont nous avons un jour admiré la beauté, que sont-ils devenus ? Ils sont déchus, salis, vaincus, sinon morts. Mais l’éternelle merveille de la jeunesse reste vivante et, à la contemplation d’un nouveau corps jeune, certaine ressemblance parfois éveille un écho, une trace de celui que jadis nous avons aimé. Cependant, à la pensée que vingt ans séparent l’un de l’autre, que cet être n’était pas encore né quand le premier portait déjà allumée la torche inextinguible que les générations se passent de main en main, une douleur impuissante nous assaille, car nous découvrons, derrière la persistance de la beauté, la fugacité des corps. Ah ! temps, temps cruel, qui pour nous tenter par la fraîche rose d’aujourd’hui détruisis la douce rose d’hier. »
Luis Cernuda
Ocnos
Traduit de l’espagnol et préfacé par Jacques Ancet
Les Cahiers des Brisants, 1987