Nouvelle rubrique : “En fouillant ma bibliothèque…” j'en partage les pépites enfouies…

« Ma phrase, au départ de mon premier feuillet, je l’ai notée deux ou trois heures après avoir ingurgité la toute dernière gorgée, bouillie bouillante, stagnant au fond du dernier jerrycan, il y avait des grumeaux de rouille qui m’ont lacéré l’œsophage, j’ai toussé des caillots de sang, jerrycan à cinq gallons, notre bon vieux bidon de bidasse, il a sans doute fait la Normandie, le jerrycan d’Omaha Beach (quel superbe octosyllabe !), une minute après la dernière gorgée j’ai vomi, une noirâtre soupe de rouille et de sang, le véhicule entre-temps doit avoir disparu, naufragé dans un creux de la dune, à quelques kilomètres d’ici, dans l’infernale immensité de l’Erg Iguidi, il n’en restera trace aucune, milliards de milliards de grains de sables jaune qui n’arrêtent pas de bouger, inexorable ressac, houle d’une monstrueuse et impitoyable lenteur qui finira par nous engloutir, heureusement que j’arrive encore à me remémorer les averses d’avril, les anémones, les colchiques, au centre de ma cervelle il me reste des images et des mots, ça me rassure, me console presque, des images surgissent, clignotent puis disparaissent, combien de millions d’images ai-je pu engranger dans le grenier frontal, les Baigneuses de Renoir, les Cavaliers d’Ucello, les Miracoli de Marino Marini, combien de millions d’images sont déjà encapsulées à jamais dans les strates desséchées de mes méandres cervicaux, mais elles continuent à irradier loin de moi, sans moi, elles n’ont jamais eu besoin de moi, et je ne m’en étais pas rendu compte, ce qu’on ne peut pas taire, il faut le dire, eux aussi me clignotent dans la tête, Wittgenstein dans le blockhaus norvégien, Montaigne sans sa ronde tour, Urabe Kenko dans son pavillon, Han Shan dans sa grotte, Thoreau dans sa cabane, Wim le Toltèque dans son Angle Mort au milieu des champs de maïs, Perros dans ses successives mansardes, la petite Saumont séquestrée avec quelques bics et une épaisse rame din a4 90g sous les solives de la Villa Mont-Noir, Bernardo Soares coincé derrière son pupitre dans le bureau des Douradores, rafale d’images, ils me passent par la tête et s’abîment, ils m’ont tous, chacun à sa manière accompagné et protégé, je les évoque, invoque, ils ne peuvent rien pour moi, ils ont déjà tout donné, tout ça finira sous une épaisse couche de sable, j’aimais les fines observations de Sei Shonagon, elle remarqua comment une tige d’armoise se prit dans une roue du chariot, s’enroula autour de l’essieu, et, broyée, répandit sa senteur, elle nota tout ça, et ça m’est resté dans le système, l’armoise-mot et l’armoise-image. »
Lambert Schlechter
Jamais je n’ai eu soif autant (récit posthume)
In “Frontière belge 98”, Histoires d’eaux
Ouvrage collectif
Coll. « Escales du nord », Le Castor Astral, 1998
rééd. dans Partances, L’Escampette, 2003

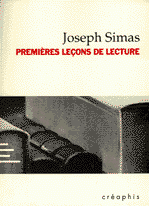







 « les mots ils n’ont pas d’ordre disent plus ou moins laissent entendre ce qui ne sera pas tenu sont-ils pour finir entièrement soumis à un ordre révélateur qui les mettrait à jour rigueur des mots une phrase déployant ne retenant que pour jeter d’un côté imprévu la marge invisible visible d’une manière de parler qui reprend les éléments d’une histoire et les éclaire jetant aussi un doute complet sur une telle histoire cherchée structure du livre à l’intérieur du désœuvrement
« les mots ils n’ont pas d’ordre disent plus ou moins laissent entendre ce qui ne sera pas tenu sont-ils pour finir entièrement soumis à un ordre révélateur qui les mettrait à jour rigueur des mots une phrase déployant ne retenant que pour jeter d’un côté imprévu la marge invisible visible d’une manière de parler qui reprend les éléments d’une histoire et les éclaire jetant aussi un doute complet sur une telle histoire cherchée structure du livre à l’intérieur du désœuvrement