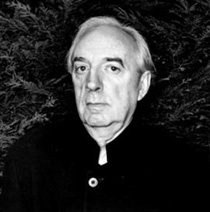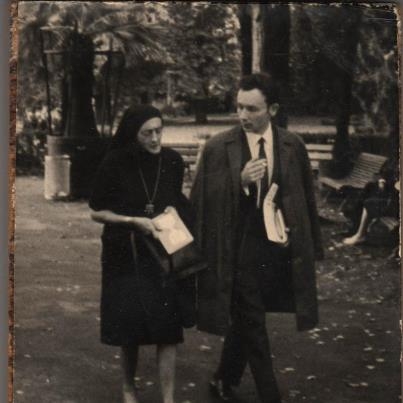Thérèse d’Avila, « Livre de la vie »

« 26. Elle s’afflige de s’être souciée naguère du point d’honneur et d’avoir commis l’erreur de croire que ce que le monde appelle honneur était honneur ; elle voit là un énorme mensonge dont nous sommes tous dupes. Elle comprend que le véritable honneur n’est pas menteur, mais vrai, car il estime ce qui est estimable et tient pour rien ce qui n’est rien : tout n’est en effet que néant, et encore moins que néant tout ce qui passe et ne plaît pas à Dieu.
27. Elle rit d’elle-même, du temps où elle faisait cas de l’argent et le convoitait ; pourtant, jamais vraiment sur ce point, elle croit n’avoir eu à confesser de faute ; mais en faire cas était déjà une faute grave. S’il pouvait servir à acheter les biens que je vois maintenant en moi, je l’estimerais fort ; mais l’âme voit que ces biens s’obtiennent en renonçant à tout.
Qu’achète-t-on avec cet argent que nous désirons ? Est-ce une chose de prix ? Une chose durable ? Et dans quel but la désirons-nous ? C’est un bien triste repos que nous recherchons et qui nous coûte fort cher. Bien souvent il nous procure l’enfer et l’on achète un feu éternel et une peine sans fin. Oh, si tous les hommes jugeaient sa possession comme celle d’une terre ingrate, quel accord régnerait dans le monde, que de tracas on s’épargnerait ! Comme nous vivrions tous en bonne amitié, si les intérêts qui naissent de l’honneur et de l’argent venaient à disparaître ! Je crois que toutes choses trouveraient remède. »
Thérèse d’Avila
Livre de la vie
Traduit par Jean Canavaggio
in Thérèse d’Avila — Jean de la Croix, Œuvres
Bibliothèque de la Pléiade, 2012

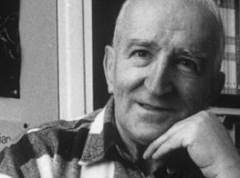

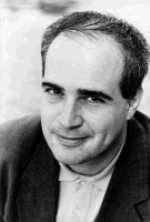

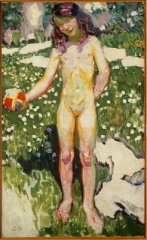
![Gérard 1[1]_face0.jpg](http://www.unnecessairemalentendu.com/media/02/02/58922176.jpg) Gérard Haller
Gérard Haller