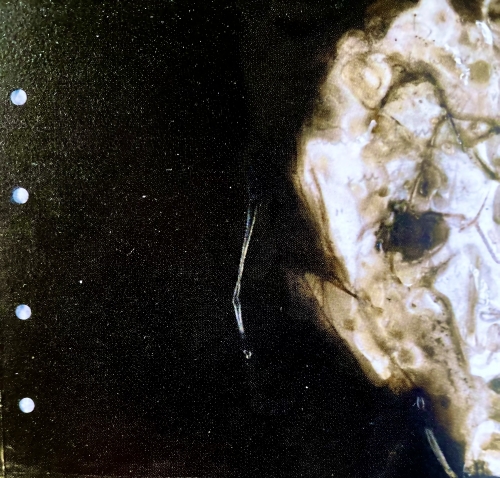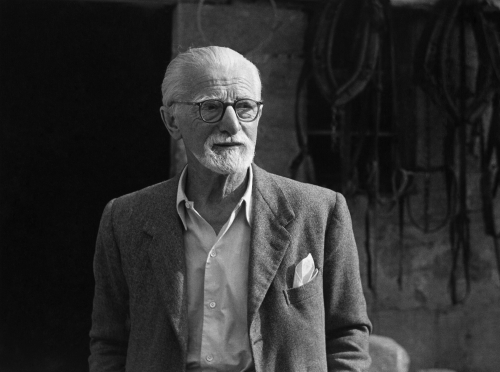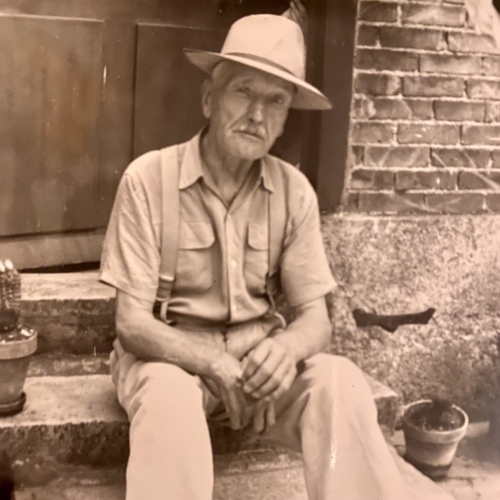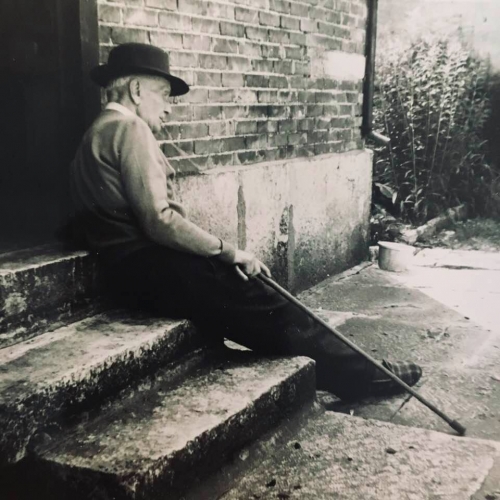Emily Dickinson, « Je ne l’ai pas encore dit à mon jardin… »

« Je ne l’ai pas encore dit à mon jardin –
De peur d’y succomber.
Je n’ai pas tout à fait la force à présent
De l’apprendre à l’Abeille –
Je ne le nommerai pas dans la rue
Les boutiques me dévisageraient –
Qu’un être si timide – si ignorant
Ait l’aplomb de mourir.
Les collines ne doivent pas le savoir –
Où j’ai tant vagabondé –
Ni révéler aux forêts aimantes
Le jour où je m’en irai –
Ni le balbutier à table –
Ni sans réfléchir, au passage
Suggérer que dans l’Énigme
Quelqu’un en ce jour marchera – »
Emily Dickinson
Car l’adieu, c’est la nuit
Choix, traduction et présentation de Claire Malroux
Poésie / Gallimard, 2000
Pour ce 15 mai 1886.