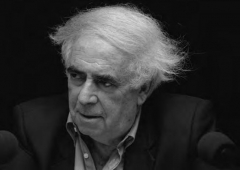
DR
« Si je pensais, c’était une falaise
à l’horizon, des routes
vides,
un soleil invisible sur la mer, ce rose
dans les roseaux, comme
du vent solide, l’air qui devient
blanc, c’était
une falaise d’ocre avec la main
qui l’inventait
sur un carré de toile et trois couleurs.
———————————————
Les morts n’ont pas
de lieu, pas d’ombre à eux, mais
ils durent dans les yeux
des autres, ceux qui sont là, les morts
le savent, ils se souviennent
et c’est une façon à eux
de vivre une seconde fois sans que rien
maintenant les blesse et c’est
trop de douleur pour ceux qui restent, trop
de malheur qu’il faut chasser pour être un peu.
———————————————
Peut-être viendra-t-elle
et je ne la reconnaîtrai plus, un soir,
elle, si jeune maintenant et brune, sans que
j’entende ses pas
et ce sera brusquement
le même désir emmêlé de nous et
je toucherai cette bouche
qui ne peut mentir
ni me dire qu’on l’attend ailleurs et que ce soir
elle passait très vite.
———————————————
Frères, hommes, humains, un autre
vous appelait ainsi et vous l’avez laissé
mourir très loin de son amour, frères,
faut-il encore
qu’on s’adresse à vous, dans la hâte,
dans le tourment des os, frères, n’êtes-vous là
que pour cet unique regard
sur ceux qui partent, qui sont
là, qui ne sont plus là,
et vous devant, frères vivants, qu’on aime encore.
———————————————
Une femme a souri
dans son sommeil et dehors
le premier oiseau commence à dire
que c’est l’aube et cette femme
bouge un peu, elle a des seins
qu’il faudrait caresser, je crois, pour
vivre encore, un peu
de temps encore et je suis
là, près d’elle, comme
une pierre et cette femme qui sourit existe au loin.
———————————————
La porte, la dernière, la plus
obscure
est ouverte, sache-le, nuit et jour,
personne jamais ne la referme,
aussi ne te hâte pas, tu franchiras
le seuil à ton heure, quelqu’un
veille là-bas qui n’a pour tâche que le poids
des âmes, les corps
eux, ne souffrent plus ni
ne se souviennent, ni ne reviennent non plus.
———————————————
Mais n’est-ce pas
dans un soir comme celui-ci,
facile, la terre
a des façons très douces
de vous endormir, il y a, un peu
partout, dans le ciel au-dessus, des
anges, des chants
qu’on n’entendait presque plus, c’est
peut-être la fin
et c’est facile, il suffit de fermer les yeux. »
Claude Esteban
Sept jours d’hier
Fourbis, 1993
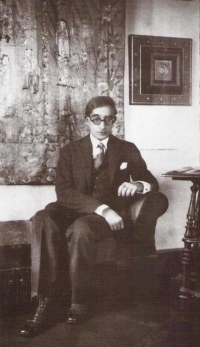

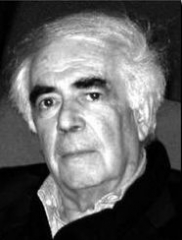
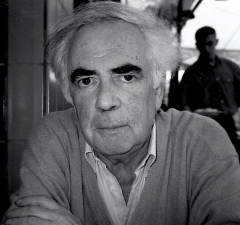
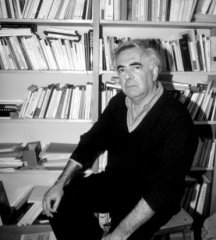
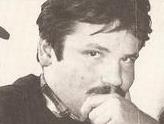

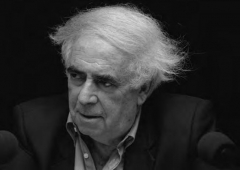


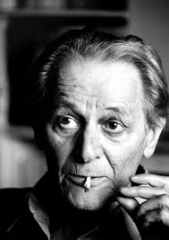
 « Les entrailles de l’âme qui ouvrent les plaines sans lier les convois qui l’enlacent entendent le pas du vent
« Les entrailles de l’âme qui ouvrent les plaines sans lier les convois qui l’enlacent entendent le pas du vent