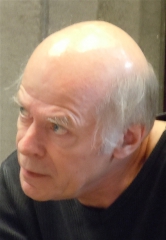Luba Jurgenson, « Au lieu du péril »

« Les mots qui vivent tellement plus longtemps que nous, qui voient se succéder tant de générations, les mots qui vieillissent en beauté et, une fois morts, ressuscitent sous une autre apparence, qui survivent avec des organes en moins ou en plus, qui voient leur corps se transformer, se déformer, muer, qui perdent des bouts lors de réformes d’orthographe, les mots qui se font écorcher vifs, qui se font torturer, ou au contraire glorifier et porter sur les slogans, les mots qui sont les témoins les plus fidèles et les plus infidèles de l’histoire humaine, se font toujours ramener à leur origine par des savants qui veulent leur faire dire ce qu’ils ont été au moment de leur apparition parce qu’ils croient à la vérité de l’origine. Les mots doivent toujours présenter leur acte de naissance alors que celle-ci se perd dans la nuit des temps. Mais le bilingue sait, pour s’être penché dessus, que leur berceau est vide, que l’origine a été dérobée par des gens du voyage – partie sur les routes, l’origine, pour mendier, recueillir des nourritures de hasard. »
Luba Jurgenson
Au lieu du péril
Verdier, 2014