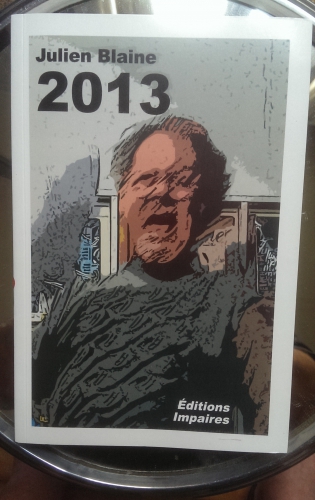Cécile Mainardi, « Rose activité mortelle »

« Le poète est celui pour qui chaque jour est différent, écrit le poète Umberto Saba. Est-ce parce qu’il est poète que chaque jour est pour lui différent ? Ou est-ce parce que chaque jour est pour lui différent qu’il est poète ? Est-ce que le fait d’écrire développe chez lui cette sensibilité-là à la non-régularité des jours/ la singularité des instants ? Ou est-ce qu’une allergie à leur monotonie lui fait préférer à toute autre activité, celle si nuancée d’écrire ? C’est là un exemple de commutativité étrange et fascinante qui s’opère à l’intérieur de cette phrase. Il y a des jours où je n’arrive plus à la comprendre et où son sens m’échappe entièrement. D’autres jours, où il me semble qu’elle n’en a jamais eu qu’un qui me déçoit presque parmi tous ceux dont je la parais, ou alors que c’est moi qui débloque/ surinterprète/ vais chercher midi à quatorze heures. Puis le lendemain, elle n’a plus qu’un sens à nouveau, seul et unique cette fois, d’une incomparable profondeur, et elle ne m’a jamais paru aussi vraie. Étrange phrase à coefficient de vérité variable (qui produit sur moi je ne sais quel charme de sens) (dont pour moi chaque jour la virginité se rejoue) et qui me porterait à croire que le poète est aussi celui pour qui chaque phrase est différente. »
Cécile Mainardi
Rose activité mortelle
Flammarion/Poésie, 2012