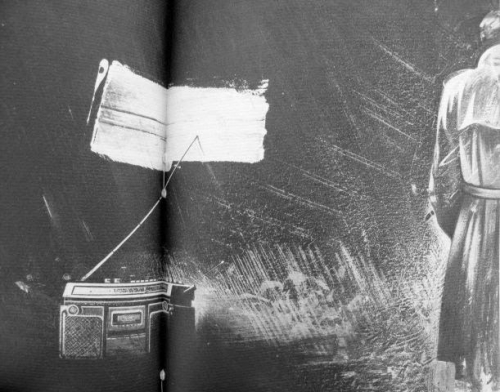Salah Stétié, « Cinq poèmes de “Inversion de l’arbre et du silence” »
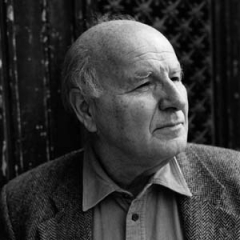
DR
« Dans le cercle du cercle
Est le cercle, est le contenu du cercle
Endormi dans l’oiseau
Au bois très frais de la pluie effrayée
Contenu dans le contenu du doute
: Oiseau de pluie sorti
Le goudronneux l’oiseau
Enfermé dans le doute
Fils du deuil il rompt les fagots de pluie
*
Dans l’immortalité de ce mourir
Avec le bois renoncé de la forêt
Et la fillette et la violette et la craie
La brume ensemencée étant brume
Le soudain corps – brisé sa lampe : larme
Ô recueillie et prise aux cils errants
Le corps ayant brisé sa lampe
Une fillette a recueilli ce peu
De rien au désordre du verre
*
Quelle eau très pure
près des larmes ?
Et qui retient l’éplorée d’une brume
Son bois tremblé
Luttant de ruse avec le rossignol
*
Le livre, le rompu, l’indécidé
En absolu théâtre
Et la poupée de son cri s’est éloignée
Voilée de vin, voilée de pauvre blé
Aux fins du pain inexpliqué, aux fins
, Livre enterré, du blé qui sera blé
Livre enterré dans la terre du livre
Comme poupée séparée de son cri
À l’aube, au tranchant vieilli des charrues
*
L’herbe qui bruit, enfance
Avant mourir, source lavée
Par l’herbe uniquement, tenant
Un peu de neige au feu de la poitrine
La terre aussi : image
Atteinte à la pointe arquée de libellule
Avant la mort, centre
Au centre de cela inapparue
Puis parue Oh ! ô blé de transparence
Par le cristal du centre
Du centre de cela formé de neige
Au point du centre de cela (…) dans le souffle »
Salah Stétié
Inversion de l’arbre et du silence
Gallimard, 1980