
Dernière séance de
Marcher sur la tête
13 juin 2010
W. G. SEBALD
lectures par Marie Frering, Gérard Haller, Isabelle Baladine Howald et Edmond Lopez
PROGRAMME • 11 h : LECTURE ; 13 h : DEJEUNER pour ceux qui le souhaitent (réservation obligatoire, jusqu’au samedi 12 juin inclus, Pierre Schoch, 03 88 08 35 95, instant@lehohwald.com) ; 14 h 30 : LECTURE. Lectures, 5 € chacune ou forfait avec déjeuner, 15 € • ACCUEIL • Marlies et Pierre Schoch, L’INSTANT, Chambres et tables d’hôtes, 39 rue du Eck, Le Hohwald
“[…] juste après le Nouvel An, dans la perspective de la visite d’une commission de la Croix-Rouge prévue pour le printemps 1944 et envisagée par les instances compétentes du Reich comme une bonne occasion de dissimuler la réalité des déportations, allait être engagée ce qu’on appela une action d’embellissement, consistant pour les habitants du ghetto à venir à bout, sous l’autorité de la SS, d’un programme faramineux d’assainissement : ainsi, on aménagea pelouses et chemins de promenade, cimetière paysagé avec urnes funéraires et columbarium, installa des bancs publics et des panneaux indicateurs joliment ornés à la manière allemande, en bois sculpté, agrémentés de décors floraux, on planta plus d’un millier de rosiers, créa une crèche et un jardin d’enfants avec frises en rinceaux, bacs à sable, pataugeoires, manèges ; quant à l’ancien cinéma Orel, qui jusqu’alors avait servi d’abri de fortune pour les plus vieux des habitants et où pendait encore du plafond, au milieu de la salle plongée dans la pénombre, le lustre gigantesque, il fut en quelques semaines transformé en lieu de théâtre et de concert, tandis que par ailleurs, avec des marchandises et matériels provenant des entrepôts de la SS, furent ouverts des magasins d’alimentation et d’articles de ménage, d’habillement pour dames et messieurs, de chaussures, linge de corps, valises et nécessaires de voyage ; désormais il y avait aussi une maison de repos, une maison de prière, une bibliothèque de prêt, un gymnase, et l’on ne cessa d’améliorer et d’embellir, de scier, de clouer, de peindre et de vernir jusqu’à ce qu’arrive le moment de la visite et que Theresienstadt, après qu’on eut une fois encore, au milieu de tout ce branle-bas, pour éclaircir les rangs en quelque sorte, expédié à l’Est sept mille cinq cents personnes parmi les moins présentables, eût été transformé en décor potemkinesque propre à tourner la tête à plus d’un de ses détenus ou pour le moins à susciter en eux certains espoirs, métamorphosé en un Eldorado où la commission, composée de deux Danois et d’un Suisse, lorsqu’elle fut promenée dans les rues selon un itinéraire et un minutage précis élaborés par la kommandantur et foula les trottoirs propres, frottés le matin même à l’eau de lessive, put voir, de ses yeux voir, ces gens aimables et satisfaits, épargnés par les horreurs de la guerre, penchés à leurs fenêtres, ces gens proprement mis, ces rares malades si bien soignés, ces repas corrects et ces portions de pain servis en gants de fil blanc dans des assiettes de porcelaine, ces affiches placardées à chaque coin de rue pour annoncer manifestations sportives, spectacle de cabaret artistique, théâtre, concert, voir ces habitants de la ville s’égailler le soir après le travail pour prendre l’air sur les bastions et les remparts de la forteresse, presque comme des touristes en croisière sur un transatlantique, un spectacle somme toute rassurant, que les Allemands, une fois la visite terminée, soit à des fins de propagande, soit pour légitimer à leurs yeux toute cette entreprise, fixèrent sur un film qui, comme le relate Adler, dit Austerlitz, en mars 1945, alors qu’une majorité des protagonistes n’étaient déjà plus de ce monde, fut encore agrémenté d’une musique populaire juive, et dont, semblerait-il, il se soit trouvé après la guerre, en zone d’occupation britannique, une copie que lui, Adler, dit Austerlitz, n’a toutefois jamais vue, et qui apparemment a aujourd’hui disparu. Pendant des mois, continua Austerlitz, m’adressant à l’Imperial War Museum et autres établissements, j’ai tenté en vain de retrouver des traces de ce film, car, bien qu’avant de quitter Prague je sois encore monté à Theresienstadt et que j’aie étudié jusque dans sa moindre note la description rédigée par Adler avec le soin qu’on sait, il m’a été impossible de me replonger dans l’atmosphère du ghetto et de m’imaginer qu’Agáta, ma mère, ait pu à l’époque se trouver en cet endroit. Je ne cessais de penser que si seulement le film refaisait surface je pourrais peut-être voir, ou pour le moins avoir une idée de ce que cela avait été en réalité, et je me prenais constamment à songer que sans le moindre doute Agáta m’apparaissait, sous les traits d’une femme jeune, comparée à l’homme que j’étais devenu, parmi les clients à la terrasse du faux café, ou en vendeuse d’articles de mode, en train d’extraire précautionneusement une paire de gants d’un des tiroirs, ou encore en Olympia dans le spectacle des Contes d’Hoffmann, qui, ainsi que le relate Adler, a été représenté à Theresienstadt dans le cadre de l’action d’embellissement. Je croyais également la voir, dit Austerlitz, marchant dans la rue en robe d’été et manteau de gabardine légère : seule, au milieu d’un groupe de flâneurs du ghetto, elle venait directement à ma rencontre et s’approchait pas à pas jusqu’à ce que pour finir j’eusse l’impression qu’elle sortait du film et se fondait en moi. Ce genre d’hallucinations explique que je me sois retrouvé dans un état d’extrême agitation le jour où l’Imperial War Museum réussit, par l’intermédiaire des Archives fédérales de Berlin, à se procurer une copie sur cassette du film de Theresienstadt que je recherchais. Je me revois encore dans une des cabines vidéo du musée, dit Austerlitz, glissant la cassette de mes mains tremblantes dans la fente noire du magnétoscope, puis, sans que je sois en mesure d’enregistrer quoi que ce soit, regardant défiler sous mes yeux diverses scènes d’ouvriers au travail, à la forge devant l’âtre et l’enclume, dans l’atelier de poterie et de sculpture, dans la maroquinerie – succession incessante et insensée de gestes et de bruits, coups de marteau, tintements de pierres à aiguiser, grésillements de soudure, découpage d’empiècements, encollage, couture –, voyant surgir à la chaîne pour une fraction de seconde ces visages étrangers, les ouvriers et les ouvrières sortir des baraquements, le travail fini, et traverser un terrain vague sous un ciel plein de nuages blancs et immobiles, des jeunes jouer au football dans la cour intérieure d’une caserne devant un public nombreux, massé en rangs serrés sous les arcades du rez-de-chaussée, du premier et du second étage, des hommes se douchant aux bains publics, des livres empruntés à la bibliothèque par des messieurs bien mis, un véritable orchestre jouant un concert, et, à l’extérieur, au pied des remparts, dans les potagers baignés par la lumière de l’été, quelques dizaines de personnes occupées à ratisser les plates-bandes, à arroser les plants de tomates et de haricots, à débarrasser les feuilles des choux des chenilles de piérides, et ensuite, le soir venant, les gens installés sur des bancs devant leurs maisons, apparemment contents, les enfants à qui l’on permet encore de s’ébattre quelque temps, un homme lisant son livre, une femme discutant avec une voisine, d’autres tout simplement appuyées les bras croisés au rebord de leur fenêtre, comme c’était naguère l’usage à la tombée du jour. Mais, dans un premier temps, aucune de ces images ne pénétrait mon cerveau, elles papillonnaient seulement devant mes yeux dans une sorte d’irritation continuelle, qui s’exaspéra encore lorsqu’à mon grand effroi il s’avéra que cette cassette berlinoise, ayant pour titre original Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (Le Führer offre une ville aux Juifs), n’était qu’une compilation d’environ un quart d’heure dans laquelle, à la différence de ce que j’avais espéré, Agáta n’apparaissait nulle part, ne pourrait jamais apparaître, aussi souvent que je visionnerais le film et quels que soient les efforts que je ferais pour tenter de la reconnaître au milieu de ces visages fugitifs. L’impossibilité de fixer plus précisément mon regard sur ces images qui en quelque sorte disparaissaient aussitôt qu’elles avaient surgi, dit Austerlitz, m’incita finalement à me faire confectionner à partir du fragment de Theresienstadt une copie au ralenti étirant la durée à une heure entière, et de fait, dans ce document quatre fois plus long que depuis je n’ai cessé de me repasser, sont devenues visibles des choses et des personnes qui jusque-là m’étaient restées cachées. On avait maintenant l’impression que les hommes et les femmes des ateliers effectuaient leurs tâches en somnambules, tant il leur fallait de temps pour pousser l’aiguille, tant leurs paupières s’abaissaient lourdement, tant étaient lents les mouvements de leurs lèvres et ceux de leurs yeux se levant vers la caméra. Ils marchaient moins qu’ils ne semblaient flotter, comme si désormais leurs pieds ne touchaient plus le sol.Les silhouettes des corps étaient devenues floues et leurs bords s’étaient effrangés, en particulier dans les scènes tournées en extérieur, en pleine lumière, un peu comme les contours de la main humaine sur les fluographies et les électrographies réalisées à Paris par Louis Darget au tournant du siècle dernier. Les nombreuses défectuosités de la pellicule, que je n’avais guère remarquées auparavant, se diluaient maintenant en plein milieu d’une image, l’effaçaient et faisaient naître des motifs blancs et lumineux éclaboussés de taches noires, qui me rappelaient des prises de vues aériennes du Grand Nord ou encore ce que l’on voit dans une goutte d’eau examinée au microscope. Mais le plus troublant, dans cette version au ralenti, c’étaient encore les bruits. Dans une brève séquence du début, où est montré le travail du fer chauffé au rouge et le ferrage d’un bœuf de trait dans la forge d’un maréchal-ferrant, la polka enjouée, composée par je ne sais quel compositeur autrichien d’opérettes, que l’on entend sur la bande-son de la copie berlinoise, est devenue une marche funèbre s’étirant de manière quasi grotesque, et les autres accompagnements musicaux du film, parmi lesquels je n’ai réussi à identifier que le cancan de La Vie parisienne et le scherzo du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, évoluent eux aussi dans un monde que l’on qualifierait de chtonien, en des profondeurs tourmentantes, ainsi s’exprima Austerlitz, où jamais aucune voix humaine n’était descendue. Rien, du commentaire, n’est plus compréhensible. Là où dans la copie berlinoise, sur un ton fringant, en une suite de claironnements extirpés impérieusement du larynx, il était question de groupes d’intervention et de centuries qui, selon les besoins de l’heure, exécutaient les tâches les plus diverses et le cas échéant bénéficieraient d’une formation pour reconversion, de sorte que chacun, s’il le voulait, avait la possibilité de s’intégrer sans heurt dans le processus de travail, on ne percevait plus à présent, dit Austerlitz, qu’un grognement menaçant, comme je n’en avais entendu qu’une fois auparavant, il y a bien des années, un jour férié, sous la chaleur caniculaire d’un mois de mai au Jardin des plantes de Paris, alors que pris d’un malaise soudain je m’étais assis près d’une grande volière non loin du pavillon des fauves où, invisibles depuis l’endroit où j’étais et, songeai-je en cet instant, dit Austerlitz, privés de leur raison à force de captivité, les tigres et les lions, sans relâche, des heures durant, rugissaient leurs sombres plaintes. Oui, et puis il y a encore, poursuivit Austerlitz, vers la fin, la séquence relativement longue consacrée à la première d’une pièce de musique composée à Theresienstadt ; si je ne me trompe, il s’agit de l’Étude pour orchestre à cordes de Pavel Haas. Venant de l’arrière, le regard parcourt d’abord la salle aux fenêtres grandes ouvertes, occupée par un grand nombre d’auditeurs qui ne sont pas assis en rangs, comme d’ordinaire pour un concert, mais par quatre autour d’une table, comme dans une auberge, sur des chaises de style alpin sans doute confectionnées pour l’occasion dans la menuiserie du ghetto, avec un cœur découpé dans le dossier. Tout au long du concert, la caméra fixe en gros plan telle ou telle personne, entre autres un vieux monsieur dont la tête aux cheveux gris coupés court emplit la moitié droite de l’image, tandis que sur la moitié gauche, légèrement en retrait vers le bord supérieur, apparaît le visage d’une femme plutôt jeune, se détachant à peine de l’ombre noire qui l’entoure, ce qui explique que dans un premier temps je ne l’aie pas remarquée. Elle porte autour du cou, dit Austerlitz, un collier dont les trois rangs fins se distinguent à peine sur sa robe foncée à col montant, et une fleur blanche est piquée dans sa chevelure. Exactement comme les pâles souvenirs, et les rares autres indices qui me restent encore aujourd’hui, me permettent d’imaginer l’actrice Agáta, oui, c’est exactement à cela qu’elle ressemble, me dis-je, et je ne cesse de regarder ce visage qui m’est autant familier qu’étranger, dit Austerlitz, je rembobine la cassette, une fois, dix fois, et je vois le compteur dans le coin supérieur gauche de l’écran, les chiffres qui recouvrent une partie de son front, les minutes et les secondes, de 10:53 à 10:57, et les centièmes de seconde qui défilent, si vite qu’on ne peut ni les fixer ni les déchiffrer. Au début de cette année, poursuivit Austerlitz, qui comme souvent avait sombré tout en parlant dans une profonde absence, au début de cette année, dit-il enfin, renouant avec le fil du récit de sa vie, peu après notre dernière rencontre, je suis allé une seconde fois à Prague, plusieurs jours de suite, aux Archives théâtrales pragoises de la Celetná, j’ai dépouillé les registres des années 1938 et 1939 et là je suis tombé, au milieu des lettres, des dossiers individuels, des livrets de programmes et des extraits de presse jaunis par le temps, sur le portrait photographique non légendé d’une comédienne qui semblait correspondre à l’évanescent souvenir que j’ai de ma mère, et dans lequel Véra, qui auparavant avait longuement observé le visage de l’auditrice copié par mes soins à partir du film de Theresienstadt avant de l’écarter en faisant non de la tête, dans lequel Véra, donc, sans l’ombre d’un doute, comme elle le dit, reconnut Agáta telle qu’elle était à cette époque. […]”
W. G. Sebald
Austerlitz
Traduit de l'allemand par Patrick Charbonneau
Actes Sud, 2002
 « Conséquence de la dernière guerre, les partages de territoire déséquilibraient l’économie depuis déjà quelques mois quand la crise éclata. Endsen était loin d’imaginer que du chaos allait émerger cette ville dont ses poèmes avaient fixé la vision.
« Conséquence de la dernière guerre, les partages de territoire déséquilibraient l’économie depuis déjà quelques mois quand la crise éclata. Endsen était loin d’imaginer que du chaos allait émerger cette ville dont ses poèmes avaient fixé la vision. « En écrivant chacun de ses livres, l’écrivain doit résoudre deux problèmes : d’abord, est-ce faisable ? Ensuite, puis-je le faire ? Tout livre abrite une impossibilité intrinsèque, que l’écrivain découvre dès que son excitation initiale faiblit. Le problème est structurel ; il est insoluble ; voilà pourquoi personne ne pourra jamais écrire ce livre. Les nouvelles, les essais et les poèmes complexes posent aussi ce problème : le défaut structurel rédhibitoire que l’écrivain aimerait n’avoir jamais remarqué. Mais il l’écrit malgré tout. Il trouve certains moyens de minimiser la difficulté ; il renforce d’autres qualités ; il bâtit tout son récit en porte-à-faux au-dessus du vide, et ça tient. Et si c’est faisable, alors il peut le faire, et seulement lui. Car aucun des matériaux de ce livre ne suggère à un autre que lui ces possibilités de sens et de sentiments. »
« En écrivant chacun de ses livres, l’écrivain doit résoudre deux problèmes : d’abord, est-ce faisable ? Ensuite, puis-je le faire ? Tout livre abrite une impossibilité intrinsèque, que l’écrivain découvre dès que son excitation initiale faiblit. Le problème est structurel ; il est insoluble ; voilà pourquoi personne ne pourra jamais écrire ce livre. Les nouvelles, les essais et les poèmes complexes posent aussi ce problème : le défaut structurel rédhibitoire que l’écrivain aimerait n’avoir jamais remarqué. Mais il l’écrit malgré tout. Il trouve certains moyens de minimiser la difficulté ; il renforce d’autres qualités ; il bâtit tout son récit en porte-à-faux au-dessus du vide, et ça tient. Et si c’est faisable, alors il peut le faire, et seulement lui. Car aucun des matériaux de ce livre ne suggère à un autre que lui ces possibilités de sens et de sentiments. »
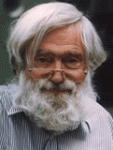 « L’Abbé disait quelquefois que les ténèbres extérieures dont parle l’Écriture ne sont pas autre chose que les ténèbres intérieures et que la chute n’a jamais eu lieu hors de soi mais toujours en soi-même. Cette pensée me revient aujourd’hui tandis que je m’efforce de retrouver les sensations passées sans vouloir – car c’était bien ainsi que je les éprouvais – les dissocier du sens qu’elles révélaient. Mais alors, assurément, penché à mi-corps et proie du vide, je ne pensais pas, j’existais hors de tout pouvoir de parole, eût-elle été la plus intérieure. Les mots, fussent-ils nés de mon obscurité, ne m’atteignaient plus parce qu’il n’y avait plus de mots.
« L’Abbé disait quelquefois que les ténèbres extérieures dont parle l’Écriture ne sont pas autre chose que les ténèbres intérieures et que la chute n’a jamais eu lieu hors de soi mais toujours en soi-même. Cette pensée me revient aujourd’hui tandis que je m’efforce de retrouver les sensations passées sans vouloir – car c’était bien ainsi que je les éprouvais – les dissocier du sens qu’elles révélaient. Mais alors, assurément, penché à mi-corps et proie du vide, je ne pensais pas, j’existais hors de tout pouvoir de parole, eût-elle été la plus intérieure. Les mots, fussent-ils nés de mon obscurité, ne m’atteignaient plus parce qu’il n’y avait plus de mots.

 « Le doute m’angoisse sans relâche. Que signifie l’illumination ? de quelque nature qu’elle soit ? même si l’éclat du soleil m’aveuglait intérieurement et m’embrasait ? Un peu plus, un peu moins de lumière ne change rien ; de toute façon, solaire ou non, l’homme n’est que l’homme : n’être que l’homme, ne pas sortir de là ; c’est l’étouffement, la lourde ignorance, l’intolérable.
« Le doute m’angoisse sans relâche. Que signifie l’illumination ? de quelque nature qu’elle soit ? même si l’éclat du soleil m’aveuglait intérieurement et m’embrasait ? Un peu plus, un peu moins de lumière ne change rien ; de toute façon, solaire ou non, l’homme n’est que l’homme : n’être que l’homme, ne pas sortir de là ; c’est l’étouffement, la lourde ignorance, l’intolérable.
 « Je ne sais qui je suis, ni quelle âme est la mienne.
« Je ne sais qui je suis, ni quelle âme est la mienne. Serge Sautreau est né le 16 octobre 1943 à Mailly-la-Ville dans l’Yonne. Il est mort le 18 mars 2010. Il a co-dirigé avec Jean-Christophe Bailly la revue Fin de siècle et la Collection froide. Avec Bernard Noël, André Velter et Jean-Louis Clavé la collection et la revue Nulle Part aux Cahiers des Brisants.
Serge Sautreau est né le 16 octobre 1943 à Mailly-la-Ville dans l’Yonne. Il est mort le 18 mars 2010. Il a co-dirigé avec Jean-Christophe Bailly la revue Fin de siècle et la Collection froide. Avec Bernard Noël, André Velter et Jean-Louis Clavé la collection et la revue Nulle Part aux Cahiers des Brisants. « Ne plus tenir debout quelquefois tu disais.
« Ne plus tenir debout quelquefois tu disais. « Un homme, d’avoir tant souffert, s’est jeté dans le fleuve, et ce fut, puisqu’il s’agissait de Robert Schumann, une manière pour les autres, non pas de l’entendre mieux, mais de s’émouvoir. Peut-être que ce geste, ce dernier geste avant de disparaître, signifiait comme un appel. Mais rien ne put s’interposer, ni l’amour d’une femme, ni la grandeur de ce qu’il avait écrit. Et nous, qui venons si tard, comment faire pour le soutenir tout un moment, comment l’arracher à cette nuit, à ce flot, à ce désastre ? Aimer les morts qui sont plus nobles que nous, c'est nous donner encore une sorte d’excuse et nous enorgueillir absurdement d’être là. Où sont-ils, ces maîtres de notre âme ? Nous écoutons ce qu’ils nous ont laissé, des signes qui nous traversent, qui nous illuminent, mais eux, qui les firent surgir de leur malheur, où vont-ils ? C'est le soir, c’est un soir de ce même hiver, et je crois que je ne suis pas seul puisque je me retrouve dans la voix d’un violon et que je sais que c’est un peu de la grâce de Schumann qui m’habite, mais c’est vrai que je suis toujours moi, et que ma détresse ou mon désarroi, peut-être aussi ma confiance secrète, ce privilège d’être là et de ne pas mourir, je les dois à cette immense douleur devant laquelle je demeure démuni, rien d'autre en vérité qu’un spectateur qui passe. Et que cette substance mystérieuse de la mort me pénètre, je n’y puis rien changer. Comme ils demeurent seuls, les témoins sublimes de leur défaite, comme ils sont nus. Un accord, deux notes qui se rejoignent, et soudain l’espace les écartèle, c'est un peu de moi qui renonce à mourir, et qui va mourir là-bas, dans le mouvoir atroce du fleuve. »
« Un homme, d’avoir tant souffert, s’est jeté dans le fleuve, et ce fut, puisqu’il s’agissait de Robert Schumann, une manière pour les autres, non pas de l’entendre mieux, mais de s’émouvoir. Peut-être que ce geste, ce dernier geste avant de disparaître, signifiait comme un appel. Mais rien ne put s’interposer, ni l’amour d’une femme, ni la grandeur de ce qu’il avait écrit. Et nous, qui venons si tard, comment faire pour le soutenir tout un moment, comment l’arracher à cette nuit, à ce flot, à ce désastre ? Aimer les morts qui sont plus nobles que nous, c'est nous donner encore une sorte d’excuse et nous enorgueillir absurdement d’être là. Où sont-ils, ces maîtres de notre âme ? Nous écoutons ce qu’ils nous ont laissé, des signes qui nous traversent, qui nous illuminent, mais eux, qui les firent surgir de leur malheur, où vont-ils ? C'est le soir, c’est un soir de ce même hiver, et je crois que je ne suis pas seul puisque je me retrouve dans la voix d’un violon et que je sais que c’est un peu de la grâce de Schumann qui m’habite, mais c’est vrai que je suis toujours moi, et que ma détresse ou mon désarroi, peut-être aussi ma confiance secrète, ce privilège d’être là et de ne pas mourir, je les dois à cette immense douleur devant laquelle je demeure démuni, rien d'autre en vérité qu’un spectateur qui passe. Et que cette substance mystérieuse de la mort me pénètre, je n’y puis rien changer. Comme ils demeurent seuls, les témoins sublimes de leur défaite, comme ils sont nus. Un accord, deux notes qui se rejoignent, et soudain l’espace les écartèle, c'est un peu de moi qui renonce à mourir, et qui va mourir là-bas, dans le mouvoir atroce du fleuve. »