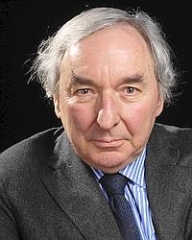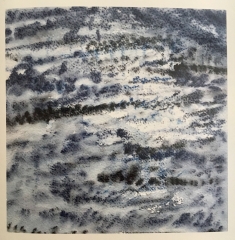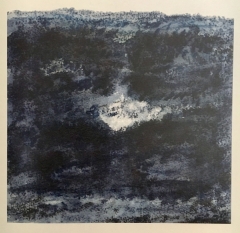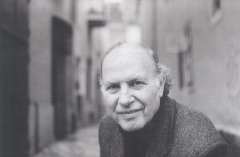Bruno Remaury, « Le Monde horizontal »

Un paléontologue amateur, un miraculé d’un coup de grisou, Leonard de Vinci, August Sander & Diane Arbus, Jackson Pollock, Christophe Colomb, Reprobus, Marie, Anna, Hans, Isaac, Francesco et quelques autres – histoire et fiction se mêlant heureusement –, Ellis Island, des grottes, des maisons, des trains, des bus, des bateaux, des essais nucléaires… une horizontalité du temps, de l’espace, notre vie en somme, rien de plus, rien de moins, dans les pas de Walter Benjamin qui nous a dit qu’il fallait, simplement, trouver les mots pour ce que l’on a devant les yeux, ce qui n'est pas si aisé. Voici donc une collection de chroniques qui se superposent, se croisent, se rejoignent, se disjoignent, façonnant un présent perpétuel et multiple épatant.
« […] Dans la grotte se scelle le pacte que l’homme passe avec la mort. On imagine ce corps couché près de la grotte, les siens qui l’ornent avant de le brûler, leurs mains qui collectent ossements et débris dans le foyer pendant que d’autres façonnent l’urne d’argile dans laquelle les rassembler avant de ramper dans l’étroit boyau puis de l’ensevelir au cours de quel rituel, chant, psalmodie, cela personne ne le saura jamais. Et on ne peut s’empêcher de penser que cette ornementation faite avec les doigts sur le rebord évasé de l’urne a peut-être été modelée par les mêmes mains dont les contours ornent les parois de la grotte pendant que leurs restes eux-mêmes, phalanges, ossements minuscules et débris calcinés, dorment dans un recoin inexploré de la Salle sépulcrale frileusement blottis dans l’argile sous leur fin drap de calcaire. Et toutes ces mains de rejoindre les autres traces que Félix a trouvées, silex, bifaces, os gravés, comme autant d’humbles curiosités, de souvenirs de fouilles, de détresse de toutes sortes qui composent les archives de l’humanité.
[…] Dans une de ses lettres, Harry dit qu’au long des immenses étendues qu’il parcourt dans ses trajets, il a parfois l’impression de rejouer la longue marche des colons qui, enclos après enclos, piquet après piquet, ont sans cesse repoussé la frontière de leurs aînés afin que s’étendent chaque fois davantage les pâles prairies et les vertes vallées, les mille et une collines de leur paradis démesuré. Une fois même il a vu devant lui, avançant sur le bas côté de l’infinie route américaine, un troupeau de bisons que suivaient quelques Sioux chevauchant des poneys. Il les a dépassés lentement sans qu’aucun d’entre eux n’en paraisse étonné, image immobile, temps indéfiniment étiré, et n’a pas su le soir s’il les avait réellement vus où s’il avait superposé à la chaleur de la plaine et à la monotonie du voyage la photo d’un groupe d’Indiens passant devant un bloc de rocher aperçue quelques jours plus tôt dans un magazine. On dit des routes américaines qu’elles suivent les chemins des colons, eux-mêmes tracés à partir des pistes de chasseurs ayant emprunté celles des Indiens nomades à la suite des voies de migration des bisons. La route américaine est un espace mental fait de lignes et de traces superposées sur lesquelles s’entrecroisent bisons, Indiens, chasseurs, colons, et encore multitude, masses de peuple, populations par millions.
[…] Marie, mais comme tant d’autres de sa génération qui ont fait le saut de ces deux guerres, de ces crises, de ces génocides, de ces empires qui s’effondrent et de ces empires qui se créent, de cette bascule d’un ordre du monde et de l’arrivée massive d’un autre venu de l’horizon, et au fond ils sont nombreux, si auparavant ils prenaient place sur la grande échelle d’August, tous ou presque à la fin se retrouvent dans un de ces mondes en soi que Diane a photographiés, figures qui n’ont pas de nom, marges abandonnées. Et nous tous aujourd’hui encore de n’être à notre tour que des éléments séparés, détachés, moins au centre de quelque chose que dispersés aux quatre coins de l’horizon ainsi que Dieu le fait des peuples qui l’ont offensé.[…]
Bruno Remaury
Le Monde horizontal
Éditions Corti, 2019