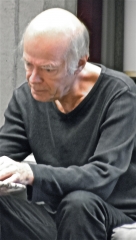Jean-Pierre Moussaron est mort hier & déjà il nous manque. J’invite quiconque voudrait le connaître mieux à se pencher sur son œuvre discrète & rare & à lire ce texte qu’il avait bien voulu donner à remue.net, à la demande de Catherine Pomparat — qui en préambule lui rend un sobre mais intense hommage —, texte où, alors qu'il n’aimait guère cela, il parle de lui, de son parcours, de ses amitiés, de ce qui l’a façonné comme nous l’aimons — http://remue.net/spip.php?article2640.
En 1997, responsable d’une revue publiée par feu le Centre régional des lettres, j’avais eu l’honneur d’accompagner Philippe Méziat dans la préparation d’un numéro spécial consacré à « Jazz & littérature » dans lequel figurait un texte remarquable de Jean-Pierre dont je livre ici un extrait. Nous avions envisagé un numéro sur « Cinéma & littérature » sous sa direction. Il était bien avancé lorsqu’hélas l’arrivée d’un nouveau responsable de cette agence du livre a fait tomber ce projet aux oubliettes. Il l’a publié sous le titre Why Not ? aux éditions Rouge profond en 2003.

Surrection du corps
Le corps comme référent : le cœur qui bat ou s’affole ; le corps qui se balance ou titube.
Le corps comme acteur : il laisse entendre les bruits de son activité : raucités, growls, souffles ; la ponctuation de ses affects : soupirs, râles, cris ; et les multiples intégrations de sa voix. Mais aussi, les marques de son travail, notamment chez les saxophonistes : bruits des tampons et des feutres, menus chocs des clefs, sifflements d’anches ; si bien que les traces de la production ne sont pas effacées par le produit.
Le corps comme retour du refoulé social de la culture occidentale : il affirme alors sa présence jusque dans la transe, communielle ou conduite, qui sollicite, par exemple, à tel moment, les formations des frères Adderley, d’Art Blakey ou d’Horace Silver. Mais aussi en tant de que sexe dévoilé : mimé ou affiché entre gestes, paroles et sons (du blues au free).
Soit, précisément, tout ce qui subvertit l’empire de la raison occidentale — id de la ratio, qui, d’abord, calcule et organise — par l’opération disséminante de la jouissance, manifestée comme dépense sans revenu ni garantie : tout ce qui, dans le même temps, déstabilise le sujet musicien, et le déporte, ne serait-ce qu’un instant, hors des prises de la conscience maîtrisante.
À quoi correspond, entre autres, dans le contenu musical lui-même, l’insistance d’éléments fortement expressionnistes : rires et mimiques de Rex Stewart et Clark Terry chez Ellington, parodies ou invectives de Charlie Mingus, pathos pluri-instrumenté de Roland Kirk, mais aussi couinements, cris et quasi-bruits tirés des saxes et des trompes par les freemen (d’Albert Ayler et Don Cherry à Charles Gayle et Lester Bowie), lesquels, plus systématiquement que les autres jazzmen, se sont attaqués à tous les canons européens de la beauté.
Cette résurrection du corps, en tous sens, dans la musique d’Occident, vérifie aussi, intensément, la pensée de Nietzsche affirmant que “la musique est le langage figuré des passions” et qu’elle “permet aux passions de jouir d’elles-mêmes” (Par delà bien et mal). »
Jean-Pierre Moussaron
Le désir du jazz, in « Jazz & Littérature », sous la direction de Philippe Méziat, les Cahiers d’Atlantiques, Centre régional des lettres d’Aquitaine, 1997
Repris dans Limites des Beaux-Arts. Tome 2. Arts et philosophie mêlées, Galilée, 2002

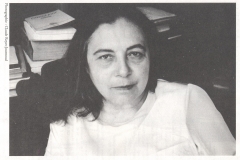

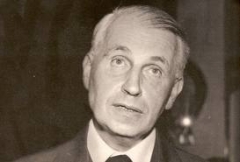


 Julien Blaine
Julien Blaine