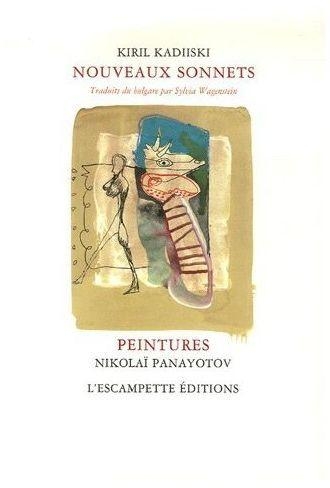« À première vue, l’aventure “littéraire” — mais elle est un peu plus que cela — de Montaigne ressemble à celle à venir, toute proche de la sienne dans le temps, celle de Don Quichotte. Pour tous les deux, la naissance a lieu à l’ombre, ou plutôt à l’intérieur du Livre. Mais la démarche est inversée. Don Quichotte veut que la réalité se conforme au texte où sa vie idéale est déjà vécue. Cette vie idéale, d’ailleurs, ne lui appartient pas en propre. Elle est la forme pure de la réalité dont le modèle n’est autre que Notre Seigneur Jésus Christ, comme l’a bien compris Unamuno. Il faut faire descendre la vérité, du ciel sur la terre, au moment où elle s’éloigne. La défaite et la désillusion sont assurées d’avance. Montaigne — enfant ébloui et enchanté par les Métamorphoses comme nos enfants par Tintin, l’adulte trouvant chez Sénèque ou Platon sa nourriture idéale — lit et découvre le Livre comme livre, autrement dit, comme jeu de fiction. Mais cette fiction a la propriété de le rendre “réel”, et de le soustraire à l’ennui ou à la contrainte des obligations qui l’empêchent d’être libre et heureux. Toute sa vie a été modelée par le principe du plaisir. Cet homme qui passe pour le plus attentif à la trivialité, qui voudrait presque être pris pour Sancho, est rêveur forcené. “Mon royaume pour un cheval” est une trouvaille de son plus génial lecteur, mais sa devise fut bien moins celle, devenue cliché, de la suspension de son jugement que celle de “mon royaume pour un coin de rêve”. Dans sa langue de seigneur de sa volonté et de ses mots, il a appelé ce coin de rêve “son arrière-boutique”, ce lieu où il peut se retirer à loisir, ce lieu que personne d’autre ne peut occuper, espace de nudité du corps et de liberté de l’esprit, pure et bienheureuse solitude. Comme un livre, précisément. Je crois que personne avant lui n’a su, avec une aussi parfaite science, que ce sont les livres qui nous lisent. Il en va de même de la parole qui ne vit que de l’écho qu’elle suscite : “la parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui l’escoute”. Toutefois, pour se dire le plus universellement possible il faut “s’écrire”, il faut devenir Livre, moins pour s’écouter que pour écouter l’autre, le monde ou l’autre soi-même auquel nous n’accédons qu’en transcrivant de la façon la plus directe et la plus drue le Livre que nous sommes. Ce n’est pas la réalité qui attend du Livre son salut, comme le croit Don Quichotte, c’est le Livre, quand il retrouve dans le réel sa fiction, qui nous libère, tous ensemble, de la réalité et de la fiction. Ce que Montaigne a compris, c’est qu’aucune réalité n’est plus fictionnelle que notre propre réalité, que le livre qui aurait un tel dessein — comme c’est le cas des Essais — serait, sur le mode de l’anti-fiction délibérée, le plus fictionnel des livres. »
Eduardo Lourenço
« Montaigne ou la vie écrite »
in Montaigne 1533-1592
accompagné d’un texte de Pierre Botineau, « L’Exemplaire de Bordeaux »
et de photographies de Jean-Luc Chapin
L’Escampette/Centre régional des lettres d’Aquitaine, 1992
repris seul sous le titre Montaigne ou la vie écrite
L’Escampette, 2004
Troisième page pour fêter les 20 ans de L'Escampette