« IL Y AVAIT DE LA TERRE EN EUX, et
ils creusaient.
Ils creusaient, creusaient, ainsi
passa leur jour, leur nuit. Ils ne louaient pas Dieu
qui — entendaient-ils — voulait tout ça,
qui — entendaient-ils — savait tout ça.
Ils creusaient, et n’entendaient plus rien ;
ils ne devinrent pas sages, n’inventèrent pas de chanson,
n’imaginèrent aucune sorte de langue.
Ils creusaient.
Il vint un calme, il vint aussi une tempête,
vinrent toutes les mers.
Je creuse, tu creuses, il creuse aussi le ver,
et ce qui chante là-bas dit : ils creusent.
Ô un, ô nul, ô personne, ô toi :
où ça menait, si vers nulle part ?
Ô tu creuses et je creuse, je me creuse jusqu’à toi —
à notre doigt l’anneau s’éveille. »

Paul Celan
La Rose de personne Traduit de l’allemand par Martine Broda
Le Nouveau Commerce, 1979,
rééd. José Corti, 2002
 « (ou est-ce perdu)
« (ou est-ce perdu)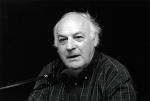 « Mais enfin un lit, même improvisé, n’est-il pas toujours un lieu que l’amour rend inaccessible, puisqu’il prescrit tout autre chose que le spectacle pour lequel il est préparé : dormir ? Nous dormons dans l’amour, en effet, mais nous introduisons un espace insoupçonné qui fait apparaître le véritable centre de la scène, la pure réciprocité. Je te caresse, tu me domines. Je te parle, tu me boudes. Je te touche, tu m’écartes. Cependant, si je ne suis qu’un point rose, je suis auprès de toi en proportion avec le ciel et la nuit où nous brillons. »
« Mais enfin un lit, même improvisé, n’est-il pas toujours un lieu que l’amour rend inaccessible, puisqu’il prescrit tout autre chose que le spectacle pour lequel il est préparé : dormir ? Nous dormons dans l’amour, en effet, mais nous introduisons un espace insoupçonné qui fait apparaître le véritable centre de la scène, la pure réciprocité. Je te caresse, tu me domines. Je te parle, tu me boudes. Je te touche, tu m’écartes. Cependant, si je ne suis qu’un point rose, je suis auprès de toi en proportion avec le ciel et la nuit où nous brillons. » « Nous vivons dans la crainte perpétuelle d’être attaqué par des bêtes dangereuses ou des ennemis féroces : le manteau magique du conte permet toutes les transformations et nous met rapidement hors d’atteinte. Combien il est difficile dans la réalité d’atteindre à un amour qui comble tous nos désirs : le héros du conte est irrésistible, ou bien il séduit d’un geste magique.
« Nous vivons dans la crainte perpétuelle d’être attaqué par des bêtes dangereuses ou des ennemis féroces : le manteau magique du conte permet toutes les transformations et nous met rapidement hors d’atteinte. Combien il est difficile dans la réalité d’atteindre à un amour qui comble tous nos désirs : le héros du conte est irrésistible, ou bien il séduit d’un geste magique. « Je me suis demandé comment la mort passait sous la langue.
« Je me suis demandé comment la mort passait sous la langue. Paul Celan
Paul Celan « Elle croyait naïvement qu’écrire allègerait sa peine, ouvrirait une brèche. Les mots n’empêchent pas de se cogner contre les murs, l’ivresse est brève de sentir les ailes du temps battre à ses tempes. L’écriture lui apporte le trop-plein de la conscience en effervescence et c’est dans ces alluvions brassées par le courant cérébral qu’elle accède momentanément à la vie. »
« Elle croyait naïvement qu’écrire allègerait sa peine, ouvrirait une brèche. Les mots n’empêchent pas de se cogner contre les murs, l’ivresse est brève de sentir les ailes du temps battre à ses tempes. L’écriture lui apporte le trop-plein de la conscience en effervescence et c’est dans ces alluvions brassées par le courant cérébral qu’elle accède momentanément à la vie. »
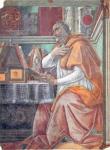 « 28. Du fond le plus secret de moi-même, mes lourdes pensées ont ramené toute la misère possible qu’elles avaient accumulée sous les regards de mon cœur. Un énorme ouragan s’est levé, provoquant une énorme pluie de larmes. Je me suis écarté d’Alypius pour laisser libre cours au fracas des larmes. J’avais besoin d’être seul pour le travail des larmes. Et je me suis éloigné pour ne pas être gêné par sa présence. Il comprit dans quel état j’étais. Oui, j’avais dû dire, je crois, je ne sais quoi d’une voix nouée de pleurs. Je me suis levé. Il est resté assis. Complètement abasourdi.
« 28. Du fond le plus secret de moi-même, mes lourdes pensées ont ramené toute la misère possible qu’elles avaient accumulée sous les regards de mon cœur. Un énorme ouragan s’est levé, provoquant une énorme pluie de larmes. Je me suis écarté d’Alypius pour laisser libre cours au fracas des larmes. J’avais besoin d’être seul pour le travail des larmes. Et je me suis éloigné pour ne pas être gêné par sa présence. Il comprit dans quel état j’étais. Oui, j’avais dû dire, je crois, je ne sais quoi d’une voix nouée de pleurs. Je me suis levé. Il est resté assis. Complètement abasourdi. « Plus nous regardions les vaches plus nous nous haïssions. À quoi aurions-nous ressemblé sans les vaches ?
« Plus nous regardions les vaches plus nous nous haïssions. À quoi aurions-nous ressemblé sans les vaches ?


 No more tears
No more tears