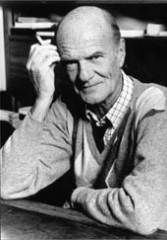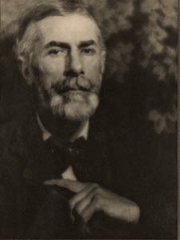Michel Vianey, « Masculin féminin, 15 faits précis. Jean-Luc Godard »

« Il arrive plus renfrogné encore que de coutume. Pas de salutations aujourd’hui. Son regard foudroie tout ce sur quoi son regard se pose comme si tout ce sur quoi son regard se posait était en travers de ce que son regard cherche.
Il a écrit ses dialogues entre Grenelle et la porte Dorée, à la station de correspondance, sur un banc, assis près d’un vieillard biscornu qui grignotait méticuleusement un biscuit sec avec sa dent, qui avait peut-être dormi là, sur le quai et qui se couvrait à présent de miettes, des genoux au menton en le regardant écrire sous une affiche barbouillée de sauce Buitoni.
En entrant il confie son cahier à Jean-Pierre et à Chantal afin qu’ils apprennent leurs dialogues, puis il commande un café au comptoir. On gravite autour de lui, les assistants, Willy, mais à distance. Il est comme entouré d’une palissade. On ne lui parle pas. Ses vieux fidèles non plus. Mal luné, il répondrait brutalement et comme on ne sait jamais, on s’abstient. Mal luné, il est capable de tout. De renverser la Mitchell, comme il fit pendant la réalisation de Pierrot, d’un coup de pied à l’appareil, en équilibre précaire sur un cube ou deux. Ce jour-là Roul Coutard s’emporta. Cet accès de colère qui l’atteignait par ricochet le mit hors de lui, la vérité étant qu’Anna n’avait pas appris les paroles de sa chanson parce qu’elle n’avait pas envie de chanter ce matin-là et que ce coup de pied lui était, en esprit au moins, destiné.
Le téléphone sonne. C’est pour Jean-Pierre.
Pour moi ? Oui, oui. Moi ? Aaah ?
— Faudra débrancher le téléphone, dit Toublanc.
— Pourquoi, dit Godard s’éveillant, s’il sonne la dame répondra.
— Il n’y avait personne au bout du fil, dit Jean-Pierre en revenant pantois, j’aurais dû m’en douter.
Il sa rassoit près de Chantal. Elle le tutoie la première.
“Commence”, dit-elle. Chose curieuse, on tutoie facilement ceux qu’on aime et tous ceux qu’on méprise. “Ta gueule, hé engelure ! — La tienne, hé con !” (c’était la première fois qu’on se rencontrait. Il conduisait un taxi, moi j’arrivais à sa droite de la rue Saint-Guillaume).
Ils sont assis côte à côte sur la banquette comme deux oiseaux sur une branche.
— C’est vous Madeleine Zimmer, lui demande-t-il, j’ai un ami qui vous connaît.
Godard qui dressait l’oreille et les écoutait de biais, intervient : “J’aime bien que tu dises : ‘Excusez-moi…’ ”.
— C’est vous Madeleine Zimmer ?
— Oui, pourquoi ?
— J’ai un ami qui vous connaît.
— J’aimerais bien que tu dises : “Je m’excuse, mais j’ai un ami qui vous connaît”.
Il s’éloigne les mains dans les poches, afin de ne pas les effaroucher davantage et part ailleurs, la figure crispée, comme s’il arrivait de très loin, comme s’il avait beaucoup marché, traversé des villes et des villes, chargé du poids de toutes les pierres, de tous les visages, de tout ce dont il faut se souvenir pour ne pas perdre de vue son existence dans la mêlée.
— C’est vous Madeleine Zimmer, dit Jean-Pierre. J’ai un ami… Merde, merde !
Il se donne une grande claque sur le front, il lève les yeux au plafond, mais là-haut, c’est encore un autre folio, une autre histoire. C’est vous Madeleine… Elle est belle. On pourrait facilement en pincer pour elle. Son petit nez… l’amour… la tendresse… ce visage mélodieux, ces yeux purs comme du bon lait… l’amour, je me clouerais à toi.
— Tu rêves ? dit-elle.
Dans vingt ans ils incarneront des pères, des mères. Ça vieillit aussi les acteurs. Coup de vieux. L’embonpoint, mauvaise haleine, teint de cendres. Et les mains. Regardez les mains. Visages pâteux. Les fringants jeunes premiers de notre enfance. Ah merde !
Qui nous fera jouir de ce qui sera après nous. »
Michel Vianey
Masculin féminin, 15 faits précis. Jean-Luc Godard
202 éditions, 2017




![Benoît%20Conord_web[1].jpg](http://www.unnecessairemalentendu.com/media/02/01/2078742023.jpg)