Pierre Silvain, « Passage de la morte »

« Elle s’est étendue contre le corps sans vie. Les chants des coqs la réveillent, elle a dû s’assoupir. Le meurtre n’est qu’un cauchemar qui se dissipe avec le retour du matin. Il n’est pas vrai qu’elle a tué son amant. Il dort, n’est-ce pas ? Il va revenir du sommeil où il s’est éloigné et lui parler. Elle le lui demande de toute son âme, humblement, puis comme il ne répond pas, elle l’appelle, en s’écartant de lui. Rien. Le silence. L’immobilité. Alors elle se met à hurler. L’implacable nécessité lui montre ce qu’elle doit faire : cacher l’arme abandonnée sur le lit et quand les gens arriveront, car “ils sentent le meurtre de loin”, trouver une explication. Le suicide de Michel Cantarini est la première qui s’impose, celle que lui dicte son espoir fou d’échapper à la justice des hommes. Comment a-t-elle pu imaginer que c’est cela qu’elle devra déclarer pour s’innocenter ? Le coup tiré par derrière l’accuse sans appel. Elle sera bien obligée, aussi terrible que ce soit, de reconnaître la vérité. Elle prend le revolver, l’applique sur son sein gauche. Paulina Pandolfini survit à son geste, la mort volontaire lui est refusée. »
Pierre Silvain
Passage de la morte — Pierre Jean Jouve
L’Escampette, 2007
Vingt-septième page pour fêter les vingt ans de L’Escampette
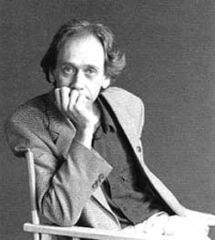


 « Je me dis qu’il faudrait inscrire dans toutes les constitutions du monde le droit imprescriptible de chacun à revenir quand bon lui semble sur les hauts lieux de son passé. Lui confier un trousseau de clés donnant accès à tous les appartements, pavillons et jardinets où s’est jouée son enfance, et lui permettre de rester des heures entières dans ces palais d’hiver de la mémoire. Jamais les nouveaux propriétaires ne pourraient faire obstacle à ces pèlerins du temps. J’y crois fort, et si je devais renouer un jour avec l’engagement politique, je me dis que ce serait l’unique point de mon programme, ma seule promesse de campagne… »
« Je me dis qu’il faudrait inscrire dans toutes les constitutions du monde le droit imprescriptible de chacun à revenir quand bon lui semble sur les hauts lieux de son passé. Lui confier un trousseau de clés donnant accès à tous les appartements, pavillons et jardinets où s’est jouée son enfance, et lui permettre de rester des heures entières dans ces palais d’hiver de la mémoire. Jamais les nouveaux propriétaires ne pourraient faire obstacle à ces pèlerins du temps. J’y crois fort, et si je devais renouer un jour avec l’engagement politique, je me dis que ce serait l’unique point de mon programme, ma seule promesse de campagne… »




