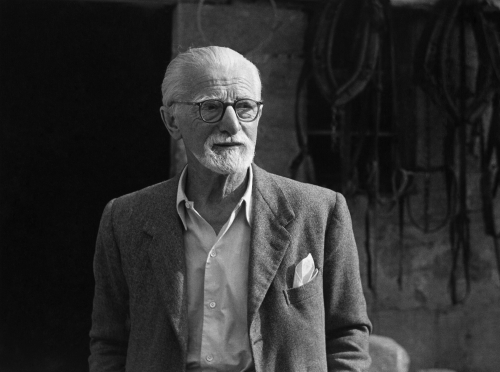Virgile, « Mais le printemps renaît ; de l’empire de l’air… »

L’éloge des abeilles. Enluminure du rouleau Exultet Barberini, vers 1087. Bibliothèque Vaticane
« Mais le printemps renaît ; de l’empire de l’air
Le soleil triomphant précipite l’hiver,
Et le voile est levé qui couvrait la nature :
Aussitôt, s’échappant de sa demeure obscure,
L’abeille prend l’essor, parcourt les arbrisseaux ;
Elle suce les fleurs, rase, en volant les eaux.
C’est de ces doux tributs de la terre et de l’onde
Qu’elle revient nourrir sa famille féconde,
Qu’elle forme une cire aussi pure que l’or,
Et pétrit de son miel le liquide trésor.
Bientôt abandonnant les ruches maternelles,
Ce peuple, au gré des vents qui secondent ses ailes,
Fend les vagues de l’air, et sous un ciel d’azur
S’avance lentement, tel un nuage obscur :
Suis sa route : il ira sur le prochain rivage
Chercher une onde pure et des toits de feuillage :
Fais broyer en ces lieux la mélisse ou le thym ;
De Cybèle alentour fait retentir l’airain :
Le bruit qui l’épouvante, et l’odeur qui l’appelle,
L’avertissent d’entrer dans sa maison nouvelle. »
Virgile
Géorgiques
Traduction de l’abbé Jacques Delille (1769)
« C’est en voyant la campagne, les moissons, les vergers, les troupeaux, les abeilles, tous ces tableaux délicieux qui ont inspirés l’auteur des Géorgiques, que j’ai cru sentir quelque étincelle du feu nécessaire pour le bien rendre. Jamais je n’ai trouvé la nature plus belle, qu’en lisant Virgile ; jamais je n’ai trouvé Virgile plus admirable, qu’en observant la nature : la nature, en un mot, a été pour moi le seul commentaire de celui qui l’a le mieux imitée. » Discours préliminaire
Gallimard Folio, 1997